Éloge de la sécurité : du droit de vivre dignement et de mourir dignement
Comme nous l'indique le dictionnaire latin-français Gaffiot, « sécurité » vient du latin « securitas » qui signifie à la fois « exemption de soucis », « tranquillité de l'âme » et « quiétude devant la mort ». Le sentiment de sécurité peut donc être assimilé à ce que les philosophes antiques appellent « l'ataraxie » : l'absence de troubles. D'après Épicure, l'ataraxie est l'état que nous devons rechercher. Le véritable plaisir, à la fois durable et sans conséquences fâcheuses, ce n'est pas la jouissance orgasmique (provoquée par exemple par l'alcool, les drogues, les voitures de course ou les autres « biens matériels » de la société consumériste), mais l'absence de souffrances physiques et morales. Le véritable plaisir, en un mot, est donc la sécurité.
La sécurité, d'après le dictionnaire Larousse en ligne, c'est la « situation dans laquelle l'on n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accidents, de vol, de détérioration. » Certes, comme le dit le proverbe populaire, « le risque zéro n'existe pas ». Vivre, par définition, est dangereux. Quoi que l'on fasse, il est impossible de vivre sans être exposé à divers risques. Lorsque Nietzsche nous invite à « vivre dangereusement », son conseil est vain, car « vivre dangereusement » est un pléonasme (l'on ne peut pas ne pas vivre dangereusement). De plus, étant donné que nous sommes mortels, « nous habitons tous une cité sans murailles », pour citer Épicure. Un jour ou l'autre, une maladie, un accident ou la vieillesse nous emportera, nous ne sommes donc jamais définitivement à l'abri du danger. C'est ce qui fait écrire à l'écrivain Bernanos une phrase simple et tranchante : « il n'y a pas de sécurité ». Cependant, dans (presque) tous les domaines, sécurité y compris, tout est question de degrés. Ce n'est pas parce que la sécurité absolue n'existe pas que nous devrions renoncer à la sécurité maximale à laquelle nous pouvons prétendre.
Que signifie concrètement « être en sécurité » ? C'est n'être exposé à aucun danger naturel ou humain. Ne pas risquer de mourir de faim, de soif ou de froid, avoir un logement décent et fonctionnel, ne pas avoir de voisins ou d'entourages dangereux, pouvoir sortir de chez soi sans risquer de se faire agresser, ne pas manquer d'argent, pouvoir se faire soigner quand on est malade... et pouvoir mourir sans douleur quand l'heure de notre trépas est venue. En un mot, que notre intégrité physique et morale soit assurée et que l'on soit en mesure d'échapper à tout excès de souffrance. Puisque « le risque zéro n'existe pas », une définition plus rigoureuse s'impose pour satisfaire les esprits les plus tatillons. « Être en sécurité », c'est n'être exposé à aucun danger probable, c'est n'être exposé qu'à des dangers qui ont peut de chance de surgir. (Par exemple, dans un endroit reconnu comme étant « paisible », nous pouvons toujours nous faire agresser par un individu violent, mais c'est peu probable : nous sommes donc « en sécurité » en dépit du faible risque d'agression). Que notre intégrité physique et morale soit a priori assurée et que l'on soit presque toujours en mesure d'échapper à tout excès de souffrance. Être en sécurité, c'est aussi être le plus possible en mesure de résoudre tous les problèmes qui peuvent se présenter à nous. Renouons dès à présent avec l'étymologie de « sécurité » : pour atteindre « l'exemption de soucis » et la « tranquillité de l'âme », il faut pouvoir « vivre dignement », c'est à dire vivre sans risquer la famine, la pauvreté, la guerre, la violence, le manque d'argent, l'absence de soins, etc ; pour atteindre la « quiétude devant la mort », il faut pouvoir « mourir dignement », c'est à dire pouvoir mourir sans souffrir et sans être délaissé ou culpabilisé par les autres. (En dépit de ce que pensent les stoïciens ou les existentialistes, il est des situations, comme la guerre, la famine, la pauvreté, la maladie ou l'agonie, où il ne suffit pas de « choisir » d'être serein pour être serein).
Pour être concrètement en sécurité, nous avons donc besoin de trois choses. 1/ Un État qui, par la police et l'armée, fasse respecter l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » En d'autres termes, lutter contre la violence sous toutes ses formes, notamment par le « monopole de la violence légitime » dont dispose l'État. Faire en sorte que l'on puisse vivre sans avoir peur de se faire agresser par nos voisins ou par les diverses personnes que l'on croise à l'extérieur. (Ce qui, bien sûr, n'enlève rien au devoir de « désobéissance civile » lorsque les lois sont injustes). 2/ Un revenu universel qui nous garantit de ne pas mourir de faim, de soif ou de froid, d'avoir un logement décent et de pouvoir nous faire soigner quand c'est nécessaire. Cela est d'autant plus important que le travail se fait à la fois rare et/ou pénible et non conforme à la dignité humaine. (Ce revenu universel pourrait être distribué sous forme de « chèques-nourriture », « chèques-santé », etc, pour éviter une mauvaise utilisation de cet argent). S'il est impossible de mettre en pratique le revenu universel, alors il est éthiquement impératif de s'abstenir de mettre des enfants au monde tant que la situation ne change pas : infliger la vie dans un monde hostile est un acte barbare. 3/ Un droit inconditionnel au suicide indolore pour toute personne majeure, afin d'être certain de pouvoir mourir en douceur quand nous le décidons, de ne plus être « enfermés dans la vie », de ne plus avoir peur de mourir et ainsi d'atteindre la « quiétude devant la mort ». Ne plus être exposé au risque d'un trépas douloureux. Nous sommes mortels, mais si une sortie paisible de la vie est aménagée, alors « mortalité » peut s'accorder avec « sécurité ».
Soyons honnêtes envers nous-mêmes : la sécurité n'est-elle pas le bien le plus désirable du monde ? Tous les autres problèmes, comparés à l'insécurité, ne sont-ils pas infimes et dérisoires ? (Tous les autres problèmes ne sont-ils pas ce que l'on appelle communément des « problèmes de riches » ?). C'est pourquoi l'enjeu fort de l'éthique est toujours la sécurité : ne pas nuire à autrui, permettre aux êtres humains de vivre dignement et de mourir dignement. La sécurité ne fait peut-être pas le bonheur, mais c'est le point de départ de tout bonheur durable.
Notons pour terminer que ceux qui prétendent me priver de ma liberté au nom de ma "sécurité" m'ôtent en réalité ma sécurité elle-même (au sens étymologique du terme) : en m'empêchant de disposer de ma vie, ils m'ôtent cette "tranquillité de l'âme" devant la vie et devant la mort qui est l'essence même de la sécurité.


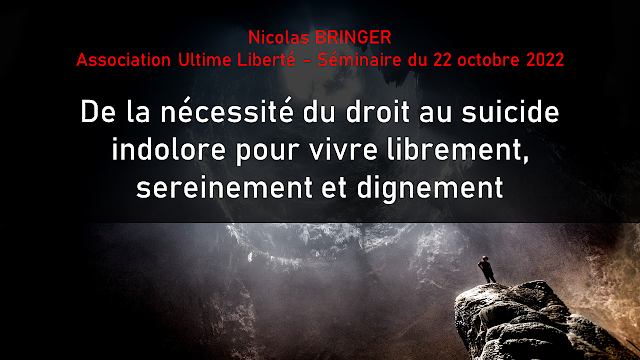

Commentaires
Enregistrer un commentaire