Frankenstein, ou les devoirs éthiques des procréateurs
Dans le célèbre roman de Mary Shelley, Frankenstein est un scientifique qui inflige la vie à un « monstre » : un être « créé » à partir de morceaux de cadavres. Après l’avoir jeté au monde, il l’abandonne – il s’en détourne par un mélange de lâcheté, de dégoût et d’effroi. Le « monstre » (au sens étymologique du mot : celui qu’on « montre » parce qu’il est différent des autres) représente en réalité un être humain confronté aux pires difficultés de la condition humaine : le délaissement, l’incompréhension, la laideur physique, le mépris, la haine, le rejet, la pauvreté, la difficulté de « gagner sa vie », le désir insatisfait, les troubles psychologiques, l’absence d’amour, l’hostilité de la Nature et des Hommes, etc. Le monstre éprouve tous les « existentiaux » du malchanceux, pour paraphraser Heidegger. Il incarne en cela la condition humaine pure, l’absurde pur, sans le secours d’autres humains. Jean-Paul Sartre écrit à juste titre : « Je ne connais qu’une Église : c’est la société des Hommes » (Le Diable et le Bon Dieu), mais le monstre – comme beaucoup d’humains en souffrance – ne bénéficie même pas des agréments de cette Église.
Or, par contraste, Frankenstein a des parents bienveillants, intelligents, cultivés, heureux, chaleureux, compétents et riches qui l’ont aimé, qui l’ont éduqué dans une atmosphère sécurisante (psychologiquement et matériellement) dès l’enfance, qui l’ont aidé à rencontrer sa compagne (sa « cousine » Élizabeth) et qui lui ont assuré financièrement sa vie entière (de manière à ce qu’il n’ait pas à travailler pour survivre et qu’il puisse ainsi, notamment, se consacrer à ses études). L’on comprend donc aisément pourquoi il peut affirmer ceci : « Durant ma jeunesse, je n'avais jamais été saisi par la tourmente et, si parfois l'ennui me prenait, la contemplation de ce qu'il y avait de merveilleux dans la nature ou l'étude de ce qu'il y avait de plus beau et de meilleur dans les œuvres des hommes venait me distraire et me rendre l'équilibre. » Ainsi, les parents de Frankenstein incarnent les « bons parents », tandis que Frankenstein lui-même représente le « mauvais parent ». Frankenstein, en tant que parent, est comme le négatif photographique de ses parents. L’idée centrale qui est derrière, c’est que l’on ne jette pas un être humain au monde sans lui devoir ensuite les conditions minimales du bonheur, car dans le cas contraire, cela revient à infliger de la souffrance. « Procréateur » rime avec « débiteur ».
Mais il faut aller encore plus loin. Frankenstein lui-même, en dépit de sa condition idéale, est malheureux. (Les tourments de Frankenstein, quoique moins violents que ceux du monstre, s’étendent sur un grand nombre de pages du roman et sont très chargés en pathos). Cela ne montre-t-il pas que l’existence est douloureuse « en soi » (du moins dans un monde aussi cruel, injuste et brutal), même sans malheurs « objectifs » ? La procréation n’est-elle pas toujours un acte violent, même si l’on peut tout offrir à celui qu’on jette au monde ? Ne vaut-il pas mieux s’abstenir de procréer pour être sûr de ne vouer personne à la souffrance ? Si le fil directeur du roman paraît être, comme on le répète à satiété, une dénonciation naïve des dérives de la science, à un niveau plus profond, il s’agit plutôt d’une réflexion sur les problèmes éthiques que pose la procréation. Jeter un être humain dans un monde aussi cruel n’est-il pas un acte barbare ? Peut-on continuer de « faire des enfants » aussi « légèrement », sans se poser de questions ? Les procréateurs peuvent-ils continuer aussi impunément de ne pas assumer leurs devoirs ? Par ces questionnements, Mary Shelley me paraît être, spirituellement parlant, la digne ancêtre de Théophile de Giraud (même si, contrairement à ce dernier, elle a eu le tort de procréer par conformisme malgré sa lucidité : l’on était encore au XIXe siècle ; la famille, l’Église et l’État avaient plus de poids qu’aujourd’hui).
« Si vous n’aimez pas la vie, vous n’avez qu’à vous suicider ! », diront probablement les chiens de garde de ce monde. D’une part, notre ADN nous pousse violemment à nous attacher à la vie, que nous le voulions ou non. Comme l’écrit Mary : « La vie est obstinée : elle se cramponne à vous, même quand on la déteste. » L'interdiction liberticide des méthodes de trépas paisible (Nembutal, etc) aggrave ce problème. De plus, si l’on cesse de surpeupler le monde en procréant, l’on peut rester en vie sans avoir un impact trop délétère sur le monde (tant sociétalement qu’écologiquement). Enfin, ce n’est pas « la vie » que nous n’aimons pas, mais « cette vie » où les souffrances prennent trop de place : à défaut d’un autre monde où nous pourrions jouir et nous réjouir sans trop souffrir, nous essayons, avant de mourir, tant que la souffrance n'est pas trop forte, de cueillir les fleurs qui sont à notre portée pour « ne pas quitter amer ou aigri le banquet de la vie » (pour paraphraser Roland Jaccard et Michel Thévoz), ce qui serait une souffrance supplémentaire (et pas la moindre !).
Pour terminer cet article, je me contenterai de citer des répliques du monstre pour montrer en quoi celui-ci incarne une sombre condition humaine et dénonce la barbarie d’un procréateur qui n’assume pas ses devoirs éthiques envers celui qu’il a jeté au monde.
Rappel de la responsabilité du procréateur : « Accomplis ton devoir envers moi et j'accomplirai le mien envers toi et envers le reste de l'humanité. » « Quel espoir puis-je mettre en tes semblables qui ne me doivent rien ? » « Mais ce n'était qu'à toi que je pouvais réclamer de la pitié et de l'aide, ce n'était qu'à toi que je pouvais demander cette justice que je cherchais en vain auprès de toutes les autres créatures humaines. » « J'avais appris par tes papiers que tu avais été mon père, mon créateur. Qui pouvait être plus attentionné à mon égard sinon celui qui m'avait donné la vie ? » « Tu me dois ta justice – davantage : ta clémence et ton affection. Oui, rappelle-toi que je suis ta créature. Je devrais être ton Adam, mais je ne suis qu'un ange déchu que tu prives de toute joie. Partout je vois le bonheur... et moi, moi seul, j'en suis irrévocablement exclu. J'étais généreux et bon, c'est le malheur qui a fait de moi un monstre. Rends-moi heureux et je serai de nouveau vertueux. » (…)
L’injustice de s’être vu infliger une vie douloureuse : « Maudit, maudit créateur ! Pourquoi est-ce que je vis ? Pourquoi, à cet instant, n'ai-je pas éteint l'étincelle de vie que tu as si étourdiment allumée en moi ? » « Maudit soit le jour de ma naissance ! » « Combien de fois n'ai-je pas voué à la malédiction celui qui avait été la cause de mon existence ! Ma bonté naturelle avait disparu et tout m'acheminait vers la haine et l’amertume. » (…)
L’hostilité de l’univers, la difficulté de survivre et de trouver un logement décent : « Je n'étais qu'un être misérable, pauvre et sans secours. Je ne connaissais rien, je ne pouvais rien distinguer. Alentour, tout me parut hostile. Je m'assis et pleurai. » « J'affrontai la nuit et la neige. Les rivières étaient gelées et la surface de la Terre était dure et froide, sans le moindre abri. » « Cependant, la nourriture se faisait rare et il m'arrivait parfois de passer une journée entière à chercher en vain des glands pour calmer les démangeaisons de la faim. » « J'ai dû affronter la fatigue, le froid, la faim. » « J’étais ravi par l'allure de la cabane. Le sol était sec, la pluie et la neige ne pouvaient y pénétrer - un endroit aussi charmant et aussi divin à mes yeux que Pandémonium aux démons de l'enfer après leurs épreuves dans le lac de feu. » (…)
L’hostilité des Hommes (surtout quand on est « différent ») : « Je bénis les cieux limpides, ils me sont plus cléments que tes semblables. » « Certains fuyaient, d'autres m'attaquèrent jusqu'à ce que, gravement blessé par les pierres et les autres projectiles qu'on me lançait, je me sauve dans la plaine et aille peureusement me réfugier dans une petite hutte. » « Voilà comment on me remerciait pour ma bienveillance ! J'avais sauvé un être humain de la mort et, pour toute récompense, je recevais une blessure qui me faisait tordre de douleur ! » (…)
La difficulté de s’intégrer à la société, de « gagner sa vie », de « trouver un emploi » : « Je décidai à tout le moins de ne pas désespérer et de me préparer d'une manière ou d'une autre à un entretien dont dépendrait mon sort. Je différai ma tentative à plusieurs mois, car l'importance que j'attachais à sa réussite m'inspirait aussi la crainte d'essuyer un échec. En outre, je constatais que mon savoir augmentait avec l'expérience de chaque jour et je ne voulais pas amorcer ce contact avant que quelques autres mois n’eussent ajouté à ma sagacité. » « Mes protecteurs étaient partis et ils avaient brisé le seul lien qui me reliait au monde. » « Parmi les myriades d'hommes, en existait-il un seul qui pourrait avoir pitié de moi ou qui pourrait me secourir ? » (…)
La souffrance d’être intérieurement différent, désavantagé physiquement, seul et incompris : « Tout, sauf moi, se reposait ou s'amusait. Et moi, démon parmi les démons, je portais l'enfer en mon sein. Ne trouvant personne avec qui sympathiser, je voulais arracher les arbres, semer autour de moi la ruine et la destruction avant de m'asseoir pour admirer mon œuvre... » « Créateur maudit ! Pourquoi as-tu fabriqué un monstre si hideux que même toi tu t’en détournes avec dégoût ? » « Quand je regardais autour de moi, je ne voyais, je n'entendais parler personne qui me ressemble. Étais-je donc un monstre, un accident sur la terre que tous les hommes fuyaient et rejetaient ? » (…)
La haine qui ronge : « Devais-je éprouver de la bonté envers mes ennemis ? Non ! À partir de ce moment-là, je déclarai la guerre au genre humain et, par-dessus tout, à celui qui m'avait façonné et qui avait provoqué en moi cette détresse intolérable. » « Excité par la souffrance, je vouai une haine et une vengeance éternelles à l'humanité tout entière. » (…)
La conscience de l’injustice sociale : « J'entendis parler de la division de la propriété, de l'immense richesse des uns, de l'extrême pauvreté des autres, de la lignée, de la descendance, du sang bleu. » « Je savais que je ne possédais ni fortune, ni amis, ni aucune sorte de bien (…). Je n'étais certes pas un individu normal. » « Mais où étaient mes amis et mes relations ? » « J'ai constamment cherché l'amour et l'amitié – mais pour être banni ! Pourquoi cette injustice ? Suis-je donc le seul fautif alors que l’humanité entière a péché contre moi ? » « En me rappelant ces injustices, le sang me boue encore dans les veines. » « À plus d'une reprise, je considérai Satan comme l'entité qui personnifiait ma condition, car souvent, comme lui, quand je voyais que mes protecteurs étaient heureux, je sentais la douloureuse morsure de l'envie. » (…)
Les questions existentielles torturantes et sans réponses : « Qu'est-ce que j'étais ? La question revenait sans cesse et je ne pouvais y répondre que par des soupirs. » « Qui étais-je ? Qu'étais-je ? D'où est-ce que j'étais issu ? Quelle était ma destinée ? Ces questions me tiraillaient sans cesse, mais j'étais incapable de les résoudre. » (…)
La souffrance de ne pas pouvoir trouver l’amour et satisfaire ses désirs en raison de sa différence physique, sociale et spirituelle : « C'était le portrait d'une très belle femme. En dépit de ma hargne, il me séduisit et me fascina. Pour un court moment, je fus sous le charme de ses yeux sombres frangés de longs cils et de ses lèvres exquises. Mais très vite ma rage reprit le dessus. Je me rappelai que j'étais à jamais privé des joies qu'une créature aussi belle aurait pu m'octroyer et je me dis que si celle dont je contemplais le visage me voyait, elle n'aurait plus cet aspect délicieux, mais une expression de dégoût et d'horreur. Peux-tu t'étonner que de telles pensées aient attisé ma fureur ? Je me demande pourquoi sur le moment même, au lieu de donner libre cours à mes sentiments de douleur par des exclamations, je ne me suis pas précipité parmi les hommes en cherchant, au risque de perdre la vie, de les tuer. Mais ces pensées m'avaient épuisé… » « Parfois, je laissais mes pensées sortir des sentiers de la raison et errer parmi les jardins du paradis, et j'imaginais que de charmantes et aimables créatures sympathisaient avec moi et m'arrachaient de mes ténèbres, tandis que des sourires de consolation irradiaient leur visage angélique. Mais ce n'était que des rêves – il n'y avait pas d'Ève pour me charmer et détruire mes peines. J'étais seul. Je me souvenais des supplications d’Adam à son Créateur. Où était le mien ? Il m'avait abandonné et, le cœur amer, je le maudissais ! » (…)
Le désespoir : « Mais, puisque j'étais haï et méprisé, toute contrée devait m'être également hostile. » « Je ne vous demande pas de compatir à ma misère. Jamais chez personne je n'ai trouvé de la sympathie ! » « Les heures, les mois de misère que j'ai vécus, rongé par mes passions dévorantes ! Et j'ai eu beau détruire les espérances de mon créateur, je n'ai jamais pu satisfaire mes propres désirs. Ils sont toujours aussi ardents et aussi inassouvis. » « Je suis misérable et abandonné, je ne suis qu'un avorton qu'on méprise, qu'on refoule et qu'on bafoue ! » (En ce sens, le monstre est aussi une allégorie du philosophe socratique que la foule condamne pour ne pas être réveillée de son sommeil dogmatique). (…)
La résignation au suicide : « Je vais mourir. Je ne connaîtrai plus jamais les tourments qui m'ont rongé, ni ces rêves impossibles. »
Chers procréateurs, ne vous sentez pas innocents aussi facilement : vous avez souvent bien plus de sang sur les mains que vous ne le pensez.


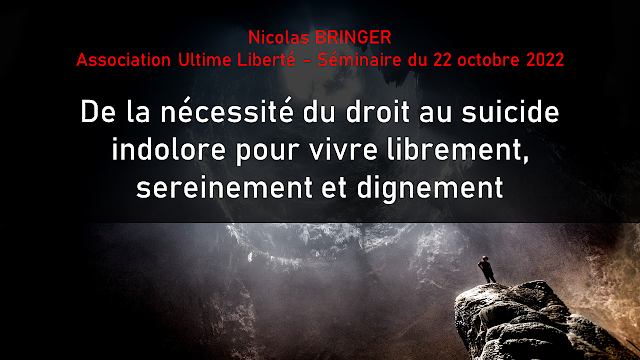

Commentaires
Enregistrer un commentaire