La Philosophie - Partie 2/4 : La culture
LA CULTURE
« Culture » vient du latin cultura qui signifie le « travail de la terre » (autrement dit l’agriculture). Cette étymologie montre que la culture est une domestication et une transformation de la nature. Ainsi, la culture se définit par opposition à la nature. La culture, au sens large, désigne tout ce qui est produit ou transformé par l’humanité : les savoirs, les valeurs, les codes sociaux, les manières de vivre, les devoirs et les interdits, les traditions, les œuvres d’art, les objets techniques, les paysages, etc. Au sens plus strict, elle désigne le développement des facultés intellectuelles : c’est en ce sens que l’on emploie le verbe « se cultiver ». L’adjectif « Intellectuel » qualifie tout ce qui sollicite l’esprit/l’intellect. En ce sens, les arts, les sports et les travaux manuels ont aussi une dimension intellectuelle (plus ou moins importante selon les activités en question). *Cultiver un champ, c’est transformer la nature hors de soi. Se cultiver, c’est transformer la nature en soi : ne plus satisfaire ses instincts comme un animal, mais comme un être humain. C’est pourquoi l’être humain n’a pas des « instincts », mais des « pulsions ». Une Pulsion, c’est un instinct accompagné de la conscience de cet instinct, un instinct dont j’ai conscience. (Puisque la conscience juge toujours le réel, une pulsion est un instinct jugé, appréhendé à travers un prisme culturel). Puisque l’être humain est conscient, il lui est impossible de vivre comme un animal. Même quand l’être humain prétend « vivre comme un animal », il s’agit en réalité d’un choix, puisqu’il en est conscient. Par exemple, un chat qui torture une souris est téléguidé par son instinct (il n’est pas coupable puisqu’il ne peut pas faire autrement), tandis qu’un homme qui torture une souris choisit de satisfaire une pulsion sadique (il est donc coupable). Seul l’être humain peut être moral ou immoral, l’animal est amoral (c’est-à-dire ni moral ni immoral mais « innocent », car il n’est qu’une marionnette de l’instinct). L’on peut opposer LA Culture au singulier, qui désigne tout ce qui est produit par l’Homme, aux cultures au pluriel, qui désignent les éléments culturels qui différencient un groupe humain d’un autre. La culture nous rassemble (en manifestant notre appartenance universelle à l’Humanité) tandis que les cultures nous séparent (en divisant l’Humanité en Communautés différentes).
Le Mythe de Prométhée et d’Épiméthée est une parfaite allégorie des origines de la culture. Épiméthée a bien équipé tous les vivants pour survivre, sauf l’Homme, qui n’a rien. (Il a équipé les prédateurs pour attaquer les proies et les proies pour pouvoir fuir leurs prédateurs, sauf l’Homme, qui est une proie sans ressources). Pour résoudre ce problème, son frère Prométhée vole le « feu » à Zeus et les « arts » (les techniques) à Athéna, pour les donner aux Hommes. En un mot, il nous donne « l’intelligence » pour que l’on puisse survivre malgré notre dénuement. L’idée qu’exprime ce mythe est donc la suivante : c’est parce qu’à l’origine, nous sommes faibles, que nous avons dû inventer la culture pour survivre. Enfin, la notion de « Nature humaine » est antinomique. En effet, l’être humain est conscience, il ne fait pas partie de la nature. (La conscience suppose une dualité entre le sujet et l’objet). Ensuite, tout ce qu’il vit a une dimension culturelle, y compris ses pulsions (car rien n’échappe aux jugements de la conscience). L’humain est donc un être au-delà de la nature.
LE LANGAGE
Le langage est un système de signes qui permet de désigner la réalité ainsi que de concevoir et d’énoncer nos pensées. Système vient du grec histemi sun qui signifie « poser ensemble ». Un système désigne donc un ensemble d’idées ou de choses qui sont posées/reliées/attachées ensemble, un assemblage ordonné où chaque élément est nécessaire à l’ensemble et en dépend. Les éléments d’un système ne font sens que les uns par rapport aux autres. Ainsi, le langage est un système, car ses sons et ses mots n’ont de sens que les uns par rapport aux autres, dans leurs rapports de similitude et d’opposition. Le langage humain a 3 grandes spécificités. Première spécificité : Il n’est pas constitué de « signaux » (c’est-à-dire d’éléments mécaniquement produits par l’instinct et agissant mécaniquement sur l’instinct), mais de « signes » (c’est-à-dire d’éléments produits intentionnellement et sollicitant l’interprétation de l’interlocuteur). Deuxième spécificité : La « double articulation » (comme l’écrit André Martinet) : à partir d’un nombre fini de sons, l’on peut produire un nombre infini de mots, de phrases et de textes (De la même manière qu’avec le clavier d’un piano, à partir d’un nombre fini de notes, l’on peut composer un nombre infini de morceaux). Troisième spécificité : La capacité d’abstraction, qui consiste à pouvoir ranger des objets divers dans le même concept. (Par exemple, pouvoir ranger tous les objets avec des racines, un tronc et des branches sous le concept « d’arbre »).
D’après Roman Jakobson, le langage a 6 fonctions. Fonction Référentielle (quand celui qui parle veut qu’on s’intéresse au contenu de ce qu’il dit). Fonction Expressive (quand celui qui parle veut exprimer ses émotions/sentiment par ce qu’il dit et la manière dont il le dit). Fonction Phatique (quand celui qui parle veut seulement établir ou maintenir le contact par ce qu’il dit, quand le contenu en lui-même n’a aucune importance). Fonction Conative (quand celui qui parle veut modifier le comportement de son interlocuteur, par exemple en lui donnant des ordres). Fonction Poétique (quand celui qui parle joue avec les sonorités des lettres et des mots). Et enfin, Fonction Métalinguistique (quand celui qui parle s’interroge sur le langage, par exemple sur le sens d’un mot, autrement dit quand le langage sert à réfléchir sur lui-même). « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. » (écrit Boileau dans l’Art Poétique) : autrement dit, comme l’écrit Hegel, Il n’y a pas de pensée sans mots. Chercher ses mots, c’est aussi chercher ses idées. Contre Bergson : il n’y a pas d’au-delà du langage. (Cependant, une réalité qu’on ignore peut nous influencer à notre insu : c’est le cas, par exemple, de certaines souffrances mentales invisibles, d’où l’importance, pour s’en distancier, de « mettre des mots (m-o-t-s) sur ses maux (m-a-u-x). » La conscience suscite également l’inconnu qui nous dépasse, elle suscite également ce qui est connaissable en droit mais non connu en fait). La conscience suscitant le monde, le langage suscite les choses (que ces choses soient réelles ou virtuelles). Ainsi, chaque langue structure le monde de manière différente. Enrichir son vocabulaire permet de susciter davantage de réalités, d’enrichir le monde. Enfin, Le Structuralisme (qui est un déterminisme, c’est-à-dire une pensée niant l’existence du libre arbitre), est la théorie selon laquelle la société est un système à l’image du langage : l’humain est une « partie » (un individu), dont l’existence est déterminée/façonnée par le « tout » (la société). Notre existence ne serait qu’un effet dont le tout est la cause. L’être humain n’aurait pas plus de liberté qu’un mot : il ne choisirait ni la définition qu’il se donne, ni sa place parmi les autres. Mais si tel était le cas, si l’être humain n’était pas libre, comment pourrait-il choisir de devenir plus lucide sur sa condition ?
L’ART ET LA TECHNIQUE
L’art et la technique sont étymologiquement équivalents, donc originellement interchangeables. Ars (en latin) est l’équivalent de teckne (en grec) : ces deux termes signifient interchangeablement art ou technique. L’art ou la technique, au sens large, c’est un ensemble de moyens (ou procédés / recettes / « savoir-faire ») employés en vue d’un but. (En ce sens, l’on peut parler « d’art » ou de « technique » pour toute activité, y compris pour la vie elle-même, comme en témoigne l’expression « art de vivre »). En un sens plus strict, il s’agit de moyens utilisés en vue de la production d’un objet. Les Objets utilitaires, comme les œuvres d’art, sont fabriqués à l’aide « d’un art » ou « d’une technique ». *Cependant, dans le sens le plus rigoureux des termes, l’on distingue la technique de l’art. La technique vise l’utilité tandis que l’art vise la beauté, ou du moins un effet esthétique. « Esthétique » vient du grec « aisthesis » qui signifie la « sensibilité ». Un effet esthétique, c’est donc un effet sur notre sensibilité (sensibilité au sens de « capacité à ressentir des émotions et des sentiments »).
Pour reprendre des concepts d’Adorno et Horkheimer, la Raison instrumentale désigne la réflexion sur les moyens, tandis que la raison objective désigne la réflexion sur les buts à atteindre. La technique relève donc de la raison instrumentale (elle est le fruit de la raison instrumentale). D’après Heidegger, la technique conduit à « l’oubli de l’être » (c’est-à-dire à l’oubli des questions philosophiques, en particulier de la question : « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ») = l’on réduit tous les problèmes à des problèmes techniques. De même, les problèmes environnementaux actuels témoignent des dangers de la technique. Mais faut-il pour autant devenir technophobe ? L’on distingue 2 types d’écologisme. Tout d’abord, l’Écologisme fondamentaliste, qui est une pensée technophobe, qui prône un retour en arrière. Ensuite, l’Écologisme réformiste (plus raisonnable), qui est une pensée selon laquelle il faut poursuivre le progrès technique, mais en le « réformant », c’est-à-dire en le rendant inoffensif (ou en tout cas moins néfaste) pour l’environnement. *Contre l’écologisme fondamentaliste, l’on peut objecter que la Nature est hostile : elle n’est ni une mère ni un ordre divin, mais un chaos (comme l’illustre bien le poème « La maison du Berger » d’Alfred de Vigny). Sans nos objets techniques, l’existence humaine serait plus pénible, plus douloureuse et moins riche. L’être humain, originellement faible, a utilisé la technique pour survivre et mieux vivre dans une Nature inhospitalière et indifférente : condamner moralement la technique, c’est donc oublier la condition humaine. En revanche, ce qu’on peut faire contre les problèmes environnementaux et l’oubli de l’être, c’est soumettre la raison instrumentale à la raison objective, autrement dit soumettre les moyens aux fins (et non définir la productivité comme un « but en soi » comme le fait le capitalisme). D’abord se fixer des horizons et des impératifs éthiques, et seulement ensuite mettre en œuvre des moyens pour atteindre ces horizons en respectant nos impératifs éthiques.
L’ESTHÉTIQUE
L’esthétique désigne une réflexion sur ce qui affecte la sensibilité (sensibilité prise au sens de capacité à ressentir des émotions et des sentiments). Est « esthétique » ce qui touche la sensibilité. En ce sens large, tout événement de la vie peut avoir un caractère esthétique. *En un sens plus précis, est esthétique ce qui affecte la sensibilité lorsque nous ne sommes plus acteurs mais spectateurs du réel. Comme l’écrit Schopenhauer, l’art nous arrache un instant à la tyrannie du vouloir-vivre (la tyrannie des instincts et des besoins) en nous rendant spectateurs de ce vouloir-vivre. (Or, être spectateur de quelque chose, c’est en être distant). Un Objet d’art est donc simplement un objet de contemplation. Tout objet (naturel ou culturel) devient un objet d’art quand il est contemplé. Être « esthète », c’est utiliser le réel à des fins esthétiques (ce qui n’implique pas, contrairement à ce qu’affirme Nietzsche, de supposer une dichotomie entre l’art et la vérité : l’art peut rapprocher de la vérité, en renvoyant par exemple à l’étonnement philosophique). La Nature n’a à l’origine aucun but esthétique, mais en la contemplant, c’est moi qui lui donne un but esthétique (qu’elle n’a pas en soi). Comme l’écrit Spinoza, ce n’est pas parce qu’une chose est belle que nous la désirons, mais c’est parce que nous la désirons qu’elle est belle. Et comme le montre Freud, l’art permet de sublimer des pulsions que la société nous interdit de réaliser. *Une Question se pose : le concept de « chef-d’œuvre artistique » est-il objectif ou subjectif ? S’il est objectif, quels critères permettent d’en juger ? De même, peut-on dire que tel paysage est « objectivement » plus beau que tel autre ? Nous laissons ici ces questions ouvertes. D’après Hegel, l’art exprime la vérité intérieure. (Nos sentiments, nos pensées, notre condition, etc). D’après Bergson, l’art révèle les mille nuances du réel que le « regard utilitaire » ne voit pas. (Par exemple, les mille différences entre les arbres existants que le regard utilitaire ne voit pas car il se contente de ranger tous les arbres existants dans le même tiroir du concept « d’arbre »). *Une cosmologie (c’est-à-dire une vision du monde) est souvent à l’arrière-plan d’une œuvre d’art. Le beau, au sens strict du terme, désigne ce qui est ordonné, harmonieusement proportionné, et renvoie donc à l’idée que le monde est un ordre (un cosmos divin). Par exemple, l’ordre du jardin de Versailles veut exprimer l’ordre divin du monde (qui se cacherait derrière le chaos apparent). *Pour Kant, le beau est ce qui plaît universellement (c’est-à-dire ce qui plaît à tous, en renvoyant à de grandes idées universelles), mais « sans concept », (car l’on ne peut pas démontrer pourquoi à l’aide de concepts). Mais au vu des différences de goût, le beau plaît-il vraiment universellement ? Échappe-t-on au subjectivisme (théorie selon laquelle tout est subjectif) ? *Le sublime désigne ce qui est chaotique, démesuré, il renvoie donc à l’idée que le monde est un chaos infini. Par exemple, le jardin anglais, qui imite la nature sauvage et renvoie au chaos infini de la Nature, peut être qualifié de sublime. Le comique désigne ce que Richter appelle le « sublime inversé » : il nous fait éprouver l’infini « d’en haut », en nous faisant rire de la petitesse de l’humain par rapport à l’infini, et non « d’en bas » comme le sublime qui nous fait considérer l’infini par rapport à notre petitesse. Le comique nous place du point de vue de l’infini pour nous faire rire de la petitesse humaine tandis que le sublime nous place du point de vue de la petitesse humaine pour nous effrayer et nous émerveiller de l’infini.
LE TRAVAIL
« Travail » vient du latin « tripalis » signifiant « qui a 3 pieux ». Tripalis a donné « tripalium » qui désigne un objet formé de 3 pieux. Il s’agit, selon les sources, d’un instrument pour attacher les animaux fougueux (afin de pratiquer des interventions sur eux), ou d’un instrument de torture. Se dégage donc l’idée que le travail domestique et fait souffrir l’être humain. Le travail entre donc en conflit avec la liberté (au sens physique et social du terme) et avec le bonheur. Nietzsche, dans Aurore, écrit que le travail constitue « la meilleure des polices » et entrave aussi le développement de la raison. Il soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie. Il est un Divertissement (au sens pascalien du terme) : il détourne des grandes questions existentielles. *André Comte-Sponville, dans son Dictionnaire Philosophique, écrit : « Le travail est une activité fatigante et/ou ennuyeuse, qu’on fait en vue d’autre chose. Qu’on puisse l’aimer ou y trouver du plaisir, c’est entendu. Mais ce n’est un travail, non un jeu, que parce qu’il ne vaut pas par lui-même, ni pour le seul plaisir qu’on y trouve, mais en fonction d’un résultat qu’on en attend (un salaire, une œuvre, un progrès…) et qui justifie les efforts qu’on lui consacre. Ce n’est pas une fin en soi : ce n’est qu’un moyen, qui ne vaut qu’au service d’autre chose. » (fin de citation). Le travail n’est toujours qu’un moyen et non un but en soi : il n’est donc pas une valeur morale ; en tant que tel, il ne vaut rien. (Tous ceux qui font du travail une « valeur morale » et qui culpabilisent ceux qui ne travaillent pas ne connaissent donc même pas la définition du mot « travail ». En effet, le travail, par définition, est un moyen et non un but en soi). *Le travail libère de la violence de la Nature sauvage (en maîtrisant/transformant celle-ci) et de nos désirs désordonnés (en disciplinant la volonté), produit et/ou entretient ce dont nous avons besoin. Hegel montre que l’esclave conquiert sa liberté en travaillant pour le maître, celui-ci devient ainsi dépendant de l’esclave. *C’est par le travail que l’on s’humanise, autrement dit, que l’on développe ses facultés proprement humaines (science, art, technique, culture, intelligences, codes sociaux, etc). (Une question se pose : comment distinguer l’inné de l’acquis dans la maîtrise d’une compétence ?) *Mais le travail est une contrainte source de souffrance. Pour comprendre cette ambivalence du travail (qui apparaît tantôt comme bon tantôt comme mauvais), il faut distinguer rigoureusement la Scholè (qui désigne le travail librement choisi ou loisir) de l’Ananké (qui désigne la nécessité, le travail contraint). *Avant de se demander si le travail est bon ou mauvais, il faut se demander ce qu’on entend par « travail ». Comme l’écrit Adam Smith, la division du travail augmente la productivité, mais abêtit le travailleur. *L’aliénation, du latin alienus qui signifie « autre », désigne la dépossession de nos caractéristiques humaines et le bafouement de notre statut d’être humain, d’où un sentiment d’être étranger à nous-mêmes. Marx montre l’aliénation que le travail provoque : le prolétaire (le travailleur qui ne survit que par son salaire) ne se reconnaît plus ni dans son activité (puisqu’il n’est qu’un infime rouage de l’entreprise), ni dans le produit de son travail (puisqu’il ne lui appartient pas). Mais surtout, il est comme dépossédé de son humanité, car il est « réifié », c’est à dire considéré comme une simple « force productive ». Le capitaliste s’enrichit par la plus-value, c’est-à-dire par la différence entre la valeur des biens produits et le prix des salaires. (Par exemple, le capitaliste va faire travailler l’ouvrier 12 heures par jour et ne le payer que 6 heures de travail si cela lui suffit pour survivre). *Comme l’écrit Proudhon, le salaire du travailleur ne dépasse guère sa consommation tandis que sa production assure l’indépendance au capitaliste (ce qui est la définition même de l’exploitation : s’enrichir par le travail d’un travailleur que l’on paye une misère). L’on peut donc bien dire, au vu de l’exploitation des travailleurs par les capitalistes, que « la propriété, c’est du vol ». Il faudrait ainsi que les fruits du travail reviennent davantage aux travailleurs. (Autrement dit, Diminuer les rapports de force). Comme le montre Freud, le travail contraint à renoncer à des pulsions, mais permet de sublimer celles-ci (de les satisfaire par des voies détournées). *Enfin, Suspendre notre survie à notre travail, c’est suspendre notre dignité à notre productivité. Cela revient à dire : Tu n’as le droit de vivre dignement que si tu travailles. Un grand but humaniste est donc de réduire les contraintes pour tendre vers moins d’ananké et plus de scholè. En effet, l’humain s’humanise par la scholè (le travail consenti et élévateur) et se dégrade par l’ananké (le travail contraint et dégradant). *Comment améliorer la condition humaine ? Proposons ici quelques solutions. Tout d’abord, Réduire le temps de travail (grâce au machinisme, à l’intelligence artificielle, etc). Ensuite, l’Abondancisme, théorie de Jacques Duboin selon laquelle distribuer aux pauvres les biens non vendus au lieu de les jeter permettrait de sauver tout le monde. Faire moins d’enfants (pour ne pas aggraver le problème de la surpopulation). Enfin, mettre en place un Revenu universel pour que le travail soit un choix libre et non une contrainte (notamment en prélevant sur les très hauts revenus). L’on pourrait veiller à ce que ce revenu soit dépensé dans des secteurs clés de l’économie. L’enjeu de toutes ces mesures serait que le travail ne soit plus une contrainte dégradante et abêtissante (ananké), mais une activité librement choisie, humanisante et élévatrice (scholè).
LA RELIGION
« Religion » vient du latin religio qui signifie scrupule, délicatesse, conscience (au sens de « conscience morale »). Cela reflète l’idée que la religion inspire la crainte de Dieu et le souci de bien agir qui en découle (l’on veut bien agir par crainte de Dieu et non seulement pour le bien lui-même). Religio vient de religare qui signifie lier, relier. La religion relie les croyants entre eux en les reliant tous à Dieu. Relegere signifie recueillir ou relire. En effet, La religion nous invite à recueillir le sens de la vie (qui nous préexisterait) et à relire en permanence les textes sacrés ou le monde lui-même (pour en saisir le sens).
La religion peut être définie comme le rapport de l’Homme au divin ou à une réalité supérieure. *Ce Rapport prend une dimension sociale en s’incarnant dans des institutions, dans des dogmes (thèses considérées comme étant indiscutables, « vérités révélées » par Dieu, auxquelles il faut adhérer même si on ne les comprend pas), dans des croyances, dans des pratiques rituelles ainsi que dans des devoirs et dans des interdits moraux. *Croire que Dieu existe signifie ne pas en être sûr, ne pas pouvoir le prouver. *Il ne suffit pas de croire en Dieu ou en des dieux pour être religieux. Notre vie, pour une religion, dépend toujours du divin. (Par exemple, Épicure croit en des dieux, mais ces derniers ne s’occupent pas de nous, donc il n’est pas religieux). *Selon le Polythéisme, il y a plusieurs dieux. Selon le Monothéisme, il n’y a qu’un seul Dieu. Selon le Panthéisme (pan signifiant « le tout » en grec), le monde est Dieu (comme pour les stoïciens). (Souvent, pour les panthéistes, le monde est Dieu parce qu’il est ingénieusement fait, mais il est amoral, c’est-à-dire indifférent à toute notion de bien ou de mal). Le Déisme, c’est la croyance en Dieu accompagnée du rejet de toute religion (faisant du rapport à Dieu un rapport uniquement personnel). L’Agnosticisme, c’est la théorie selon laquelle l’on ne peut pas savoir si Dieu existe ou non. (L’agnostique = « ne sait pas » si Dieu existe ou non, et prétend qu’on ne peut pas savoir). L’Athéisme (A privatif + theos qui signifie Dieu), c’est la théorie selon laquelle il n’y a pas de Dieu. *Une Théodicée, c’est une Théorie selon laquelle Dieu est juste en dépit des apparences. Tout d’abord, Dieu n’est pas responsable du mal (c’est toujours la faute des Hommes). Ensuite, Il n’y a jamais de « vrai mal », car le mal sert toujours un bien plus grand (ce qui implique que tout a un sens). La théodicée a donc pour but de laver Dieu de tout soupçon de méchanceté ou d’imperfection. Elle consiste donc toujours, en dernière instance, à justifier moralement ce qui nous paraît mal. *A l’intérieur même de la religion, l’on peut distinguer les Approches rationalistes consistant à vouloir comprendre Dieu, à étudier ses plans et à démontrer son existence, des approches irrationalistes selon lesquelles le conflit entre raison et foi est indépassable, ce que résume bien la formule biblique : « les voies du Seigneur sont impénétrables » (Pascal et Kant sont de cet avis) : l’on ne peut pas comprendre, l’on ne peut que croire... Objection : il n’y a rien au-delà de la raison (car il n’y a de réel que pour une conscience, c’est-à-dire pour une raison, il n’y a de réel que pour un rapport au réel). *Pour finir, relevons les deux principales réfutations de la pensée religieuse. *Réfutation morale : le mal dans le monde invalide l’hypothèse d’un Dieu à la fois bon et tout-puissant. Si Dieu existe, nous souffrons parce que nous le méritons (ce qui légitime la souffrance). Comme l’écrit le catholique Blaise Pascal, « il faut que nous naissions coupables, sinon Dieu serait injuste »). Cette idée peut d’ailleurs aider à supporter la souffrance : si celle-ci est méritée, alors elle a un sens (elle n'est pas « gratuite », elle n’est pas absurde car elle est justifiée par une fin/ elle est justifiée par un but). Dire que Dieu existe justifie le mal, ce qui est immoral. (Par exemple, dire que Dieu veut tout ce qui arrive revient à justifier le nazisme, ce qui est immoral). *Réfutation métaphysique : ce n’est pas Dieu, mais l’être humain qui suscite la réalité du monde par sa conscience. Toute chose suppose toujours une conscience qui pense cette chose. La réalité du monde suppose ma conscience.
L’HISTOIRE
*Au Sens large, l’Histoire désigne l’ensemble de tous les événements passés, présents et futurs (tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera). *Au Sens restreint, l’Histoire désigne le passé humain et la connaissance de ce passé. (Elle peut inclure des événements naturels, mais seulement s’ils ont eu une incidence sur l’humanité). La Nature est le lieu des causes et des effets tandis que L’Histoire est le lieu des choix et des conséquences de ces choix. (Même si des événements subis entrent aussi en jeu dans l’Histoire). L’Histoire regroupe l’ensemble des faits qui concernent l’Humanité. *L’on distingue Le passé, qui est l’Histoire réelle, de La connaissance du passé, qui est l’Histoire comme discipline. *Histoire vient Du grec « historia » qui signifie enquête. L’historien, comme l’enquêteur de police, étudie des traces du passé (documents, témoignages, etc) afin de découvrir « ce qui a été ». Hérodote, considéré comme « le père de l’Histoire » par Cicéron, a écrit un ouvrage traitant d’Histoire nommé Les Histoires ou L’Enquête. *L’Histoire traditionnelle est centrée sur ceux qu’on appelle les « Grands Hommes », c’est à dire les Hommes ayant « écrit » l’Histoire (les Chefs d’État, les Hommes riches et influents, etc), et les « Grands Événements ». (On célèbre la supposée grandeur de ces Hommes et de ces événements par l’utilisation d’un registre Épique ou Grandiose. [Le registre épique ou grandiose désigne un ensemble de procédés (littérature, musique, etc) visant à affirmer les exploits d’un héros, et par extension, la grandeur morale de quelque chose.] *L’Histoire traditionnelle est également Ethnocentrée (c’est-à-dire centrée sur notre peuple occidental, comme si les autres peuples gravitaient autour du nôtre et comme si notre peuple était supérieur aux autres peuples). *A l’Histoire traditionnelle s’oppose l’Histoire globale qui consiste à se placer d’un point de vue mondial et non ethnocentré, à prendre en compte tous les peuples pour étudier l’Histoire. *A l’Histoire traditionnelle s’oppose aussi l’Histoire d’en bas (ou par le bas), qui consiste à s’intéresser avant tout aux peuples dans leur vie quotidienne et non à ceux que l’Histoire traditionnelle appelle les « grands Hommes ». Contre le ton épique, l’Histoire moderne met en avant un souci d’objectivité (qui exclut tout procédé d’embellissement) et « l’Humain d’abord » (qui exclut toute affirmation de la grandeur morale de la guerre et de toutes les réalités qui bafouent la dignité humaine). Le Nouveau présupposé de l’Histoire-discipline est le suivant : ce sont avant tout les peuples qui écrivent l’Histoire réelle. Tout le monde est acteur de l’Histoire, pas seulement les supposés « grands Hommes ». *Comme l’écrit magnifiquement La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire : les « grands Hommes » n’ont que le pouvoir que les peuples leur accordent, les tyrans n’ont que le pouvoir que les peuples leur accordent. *Le Peuple peut désigner trois choses. Premièrement, Un ensemble qui dépasse l’individu. Deuxièmement, Une idée de l’individu. Troisièmement, Tous les individus (et chacun d’entre eux). Le But suprême de l’humanisme, c’est le respect de l’Individu, autrement dit du peuple dans sa troisième définition (et surtout ne pas soumettre l’Individu au Collectif. Comme l’écrit Brecht, c’est la société qui doit être au service des Hommes et non les Hommes qui doivent être au service de la société). * D’après Hegel, l’Histoire a un sens (elle va d’elle-même vers le mieux : elle est un esprit raisonnable, et l’on parle notamment de « ruse de la raison » pour désigner la ruse avec laquelle elle utilise toujours nos passions pour servir un but raisonnable : le mal est donc toujours intégré dans le plan de l’Histoire, le mal est toujours justifié par le Bien plus grand qu’il sert). D’après Schopenhauer, à l’inverse, l’Histoire n’a pas de sens, c’est « toujours le même malheur qui se répète » en dépit des apparences historiques qui changent. La troisième voie que nous pouvons emprunter est la suivante : l’Histoire n’a que le sens que nous lui donnons. *Enfin, « Notre Histoire n’est pas notre code » (comme l’écrit le révolutionnaire Rabaut-Saint-Étienne). Ce qui doit être (en droit) n’est pas déductible de ce qui a été (en fait). Dire que « X existe depuis la nuit des temps » ne légitime pas X. L’Histoire n’est jamais un argument valable pour justifier telle ou telle société. (Le fait que quelque chose « existe depuis la nuit des temps » ne prouve en rien que cette chose soit bonne).


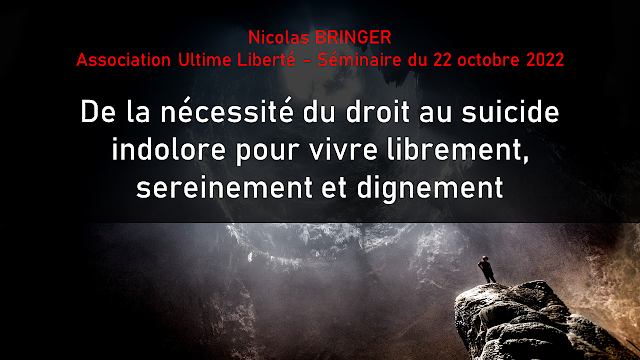

Commentaires
Enregistrer un commentaire