La Philosophie - Partie 1/4 : Le sujet
LA PHILOSOPHIE
« Philosophie » vient du grec « philia » qui désigne « l’amour » ou « l’amitié », et « sophia » qui veut dire « sagesse ». La philosophie signifie donc étymologiquement l’amour de la sagesse. La sagesse désigne à la fois le savoir et l’art de vivre. La philosophie est donc un savoir sur l’Homme et le monde et un art de bien vivre (ce dernier étant souvent déductible du savoir). Cependant, les philosophes se contredisent entre eux : ils ne partagent pas tous les mêmes thèses. En effet, ils ne proposent pas tous le même savoir et le même art de vivre. Chaque philosophe donne des réponses différentes aux grandes questions philosophiques telles que : Dieu existe-t-il ? Sommes-nous libres ? Pourquoi existons-nous ? Qu’est-ce que le monde ? L’État est-il l’ennemi de la liberté ? Qu’est-ce que le bonheur ? Comment bien vivre ? Etc. De ce constat découlent au moins deux questions. Tout d’abord, la philosophie est-elle vraiment un savoir (et non seulement une opinion) ? Ensuite, la vérité est-elle accessible ? En d’autres termes, l’impossibilité des philosophes à se mettre tous d’accord entre eux ne témoignerait-elle pas d’un échec de la philosophie ? Même sur ces questions, tous les philosophes ne partagent pas les mêmes avis.
La philosophie comporte différents domaines (qui peuvent se recouper) : La Métaphysique, qui est une interrogation sur le pourquoi de l’être : « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » comme le demandait Leibniz. L’Anthropologie, qui est une interrogation sur l’Homme. (Par exemple : qu’est-ce que l’Homme ? Est-il libre ? Etc.). L’Épistémologie, qui est une interrogation sur les sciences. La Philosophie politique, qui se demande « ce qu’est une bonne société ». La Philosophie morale, qui se demande « ce qu’est le Bien », Etc.
La spécificité de la philosophie est la suivante : elle interroge ses objets d’étude au lieu de s’en tenir à les décortiquer. Par exemple, elle se demande ce qu’est la Nature et l’Histoire au lieu de se contenter d’étudier les phénomènes naturels et historiques. L’existence peut être comparée à un chemin de randonnée. Tandis que les autres Hommes se contentent d’avancer, seuls les philosophes se demandent pourquoi ils avancent et vers où ils avancent. Pour philosopher avec rigueur, il est primordial, avant de se poser des questions trop spécifiques, de toujours expliquer précisément ce qu’on entend par les mots qu’on emploie. Par exemple, il ne faudra pas affirmer que « l’être humain est libre » sans définir rigoureusement le terme « libre ». Schopenhauer distingue l’étonnement scientifique, qui pose la question « comment ? », de l’étonnement philosophique, qui pose la question « pourquoi ? ». L’étonnement philosophique consiste à se demander « pourquoi ? » et non « comment ? ». (Non pas « Comment le réel fonctionne ? », mais « Pourquoi le réel est ? »). Tandis que les sciences questionnent le fonctionnement des choses, la philosophie questionne leur sens d’être (c’est-à-dire leur définition, leur valeur et leur but). La philosophie naît de notre étonnement au sujet du monde et de notre existence. Elle suppose que pour nous, le fait d’être ne va pas de soi mais pose question. La philosophie est ainsi une interrogation sur les essences ou « définitions » ainsi que sur les valeurs et les raisons d’être (de l’Homme et des choses). C’est parce que nous ne nous sommes pas contentés de vivre comme les autres vivants mais que, saisis d’étonnement, nous nous sommes demandé pourquoi nous existions et pourquoi le monde était que nous avons inventé la philosophie. Celle-ci est ainsi une spécificité humaine. Choisir de ne pas philosopher est aussi un choix philosophique (qui revient à considérer que la lucidité nuit au bonheur, ce qui est déjà une vision du monde et un art de vivre : l’on n’échappe donc jamais à la philosophie, même quand on la rejette).
FIL CONDUCTEUR
Sachez qu’il est impossible de présenter de façon neutre l’Histoire de la Philosophie. Même si l’on veut cacher son point de vue, celui-ci transparaît toujours d’une manière ou d’une autre. Si je prétendais être « neutre », je vous influencerais à votre insu, vous adopteriez peut-être mon point de vue sans le savoir. A l’inverse, en avouant mon point de vue, je vous donne la possibilité de critiquer celui-ci. L’être humain, d’après moi, est un être conscient, libre et source du réel, mais également faible, ignorant, contingent (c’est-à-dire « là sans raison »), « jeté au monde » sans son consentement et victime d’influences biologiques et sociales souvent inconscientes. C’est un « roseau pensant » (comme l’écrit Blaise Pascal) : il est à la fois fragile comme un roseau (parce qu’il n’est qu’un point infime dans l’univers) et puissant (parce qu’il pense).
Mon point de vue peut ainsi être qualifié d’athée et d’« existentialiste réaliste ». L’Athéisme est la théorie selon laquelle Dieu n’existe pas. L’Existentialisme est la théorie selon laquelle l’Homme est libre et « source absolue » du réel. C’est l’Homme qui fait exister le monde par sa conscience : telle est la grande thèse de la phénoménologie (l’étude de la manière dont les choses (les phénomènes) apparaissent à la conscience, mais aussi l’interrogation sur la source des phénomènes). Quand je ne suis pas conscient, rien n’existe. Absolu vient du latin absolvere qui signifie : détacher, délier, dégager. L’absolu, au sens philosophique du terme, c’est ce qui est détaché, isolé, qui ne dépend de rien d’autre que lui-même, ce qui n’est relatif à rien d’autre que lui-même. Cependant, dans l’expression « source absolue », l’adjectif « absolu » signifie « seul, unique, isolé » (car il n’y a pas d’autre source du réel que la conscience), mais non « indépendant », car la conscience et le monde sont interdépendants : il n’y a pas de monde sans conscience ni de conscience sans monde (le monde suppose toujours une conscience de ce monde et toute conscience est toujours conscience d’un monde extérieur à elle). Être la « source absolue » du réel signifie simplement « ne pas être le produit de quelque chose, ne pas être un objet ou une créature ». Mais mon existentialisme est « réaliste », car d’après moi, le réel s’impose à nous, nous contraint, nous influence et recèle toujours une très grande part d’inconnu. Le connu n’est que le sommet de l’iceberg du réel. (Tout est connaissable en droit par la raison, mais de fait, le réel étant infini, nous ne pourrons jamais tout connaître). Je peux subir des effets sans connaître les causes de ces effets. Être libre n’implique ni d’être tout puissant ni d’être toujours lucide, donc nous ne sommes pas toujours pleinement responsables de nos actes (ce que le droit reconnaît avec la notion de « circonstances atténuantes »). Être conscient, c’est susciter un réel qui nous dépasse. (Être conscient, c’est susciter l’infini, donc c’est aussi susciter l’inconnu).
PARTIE 1 : LE SUJET
LA CONSCIENCE
L’être humain, contrairement aux autres vivants, est conscient. Être conscient, ce n’est pas simplement vivre, comme l’animal, mais savoir qu’on vit et qu’il y a un monde, c’est-à-dire exister. C’est être témoin du réel. C’est être dans un rapport de connaissance aux choses (et pas seulement dans un rapport instinctif). En effet, « conscience » signifie étymologiquement « avec savoir » (« coum scientia » en latin). Toute conscience est conscience d’objets, ce qui suppose que la conscience elle-même n’est pas un objet, mais un rapport aux objets. Vivre, c’est seulement satisfaire ses instincts biologiques (manger, se reproduire, etc). Exister, c’est non seulement vivre MAIS AUSSI savoir que l’on vit. Même si je me trompe sur tout, le fait que je me trompe suppose que j’existe. Pour se tromper, il faut être (comme le montre Descartes dans ses Méditations métaphysiques). « Je pense donc je suis » (comme l’écrit Descartes dans son Discours de la Méthode). Cela signifie deux choses. Tout d’abord, pour penser, il faut être. Si je n’étais pas, je ne pourrais pas penser. Je peux douter de tout, sauf de mon existence. La conscience me définit, car elle est la seule « chose » que l’on ne peut pas m’ôter sans supprimer mon être (même en imagination, c’est inconcevable : je ne peux pas m’imaginer sans m’imaginer être conscient). Ensuite, c’est parce que je pense que je suis et qu’il y a un monde. Ma pensée est la source de tout. La réalité du monde suppose mon existence. Sans moi, sans « je », il n'y a pas de monde. Quand je pense au monde, je me suppose en train de penser au monde, donc je me suppose exister. Je ne peux pas imaginer le monde sans me supposer moi-même être en train d’imaginer le monde ! (Même lorsque je crois imaginer le monde à partir d’un autre point de vue que le mien, en fait, je l’imagine toujours à partir de mon point de vue). Un « monde » sans « moi » est inconcevable. Le monde n’existe que par ma conscience et pendant que je suis conscient. La conscience est un néant à partir duquel il y a de l’être. L’être humain n’est rien, mais c’est par ce rien qu’il y a quelque chose. « N’être rien » signifie simplement « ne pas être une chose » (n’être rien de matériel) : n’être rien est donc la marque de notre liberté et de notre dignité. « Je suis la source absolue ». (comme l’écrit Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception). C'est moi qui fais être le monde par ma conscience. Ma conscience ne produit pas le monde, mais elle le « suscite ». La conscience et le monde sont interdépendants. « Toute conscience est conscience de quelque chose ». (comme l’écrit Husserl dans ses Méditations cartésiennes). Il est impossible de penser à « rien ». La conscience vise toujours un objet extérieur à elle. Dire « je suis un objet » est contradictoire, car dire « je », c’est s’affirmer en tant que sujet distinct de l’objet. Exister, c’est étymologiquement « se tenir hors de », être hors de soi, tourné vers les choses. A la question « qui suis-je », je peux donc répondre ceci : je suis un rapport aux choses, un rapport qui change en permanence selon les situations et les valeurs que je leur accorde. Je ne suis pas un simple rapport instinctif aux choses, mais un rapport de connaissance, ce qui implique toujours une dualité entre le sujet connaissant et l’objet connu. La conscience ne se confond jamais avec ses objets : elle est toujours distincte et au-delà de ses objets. Comme l’écrit Schopenhauer, l’être humain est un animal métaphysique. Meta, en grec, signifie « au-delà ». Phusis, en grec également, signifie « la Nature », les choses matérielles. L’être humain est un animal métaphysique, car il est au-delà de la Nature : il est le seul animal à ne pas en être un. Je ne choisis pas les structures biologiques et psychologiques (corps, maladies mentales, etc) à travers lesquelles j’ai conscience du monde, ni les structures matérielles (sociales, historiques, etc) dans lesquelles je vis, mais à l’intérieur de ces structures, je fais des choix à chaque instant. Mon rapport au monde est à la fois libre et influencé/contraint par des structures. Chaque choix est unique : je change à chaque instant. Mais changer en profondeur, c’est changer son rapport au monde en dépit des structures qui s’imposent à nous.
LA CONSCIENCE MORALE
L’on dit parfois à des personnes qui ne pensent qu’à leur intérêt personnel au détriment des autres : « Vous n’avez aucune conscience ! » Dans cette affirmation, « conscience » signifie « conscience morale ». La conscience morale, c’est la capacité de distinguer le bien du mal. Il s’agit d’une faculté proprement humaine (comme le note Aristote dans l’Éthique à Nicomaque) : les notions de Bien et de Mal n’existent que pour les êtres humains. La conscience morale émet des « jugements de valeurs » (jugements qui portent sur « ce qui devrait être », par opposition au jugement de fait qui porte sur ce qui est). Que sont le Bien et le Mal ? D’où viennent ces concepts ? A ces questions, l’on distingue globalement trois réponses : Pour les religieux, le Bien et le Mal sont des absolus (ils existent indépendamment de notre volonté) qui viennent de Dieu. Pour les athées matérialistes, le Bien et le Mal sont des absolus qui viennent de la Nature : ce qui est dans la Nature, c’est ce qui doit être. Par exemple, dans la Nature, les faibles meurent et les forts survivent, donc les faibles doivent mourir et les forts doivent survivre. D’après Nietzsche, par exemple, l’on devrait aider les faibles à disparaître (même s’ils veulent rester en vie !). Enfin, pour les athées existentialistes, le Bien et le Mal sont des créations humaines relatives à la volonté humaine. « Ce n’est pas parce qu’une chose est bonne que nous la désirons, mais parce que nous la désirons qu’elle est bonne. » (écrit Spinoza dans son Éthique). Le Bien, c’est ce que nous désirons. Le Mal, c’est ce que nous ne désirons pas. Par exemple, nous ne désirons pas que les autres nous nuisent, donc nous avons défini comme un bien le fait de « ne pas nuire à autrui » (article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen), ne pas empiéter sur la liberté d’autrui, ce qui passe par le fait de protéger la dignité des faibles. C’est parce que le Bien et le Mal n’existent ni en Dieu ni dans la Nature que nous devons les inventer afin de créer un monde plus juste (c’est-à-dire un monde davantage conforme au désir de l’être humain). S’il nous suffisait d’obéir aux commandements divins (ce que suppose la morale religieuse) ou à nos instincts (ce que suppose la morale naturelle), nous n’aurions pas besoin de créer une morale. Le Bien et le Mal sont ni plus ni moins des concepts qui nous permettent de valoriser ce que nous voulons et de condamner ce que nous ne voulons pas. Cependant, il convient de distinguer, comme le fait Rousseau, les désirs universels des désirs particuliers. Les désirs universels sont relatifs à notre humanité : ils doivent « faire loi », car ils valent ou devraient valoir pour tout le monde, comme le désir d’être respecté. Les désirs particuliers, en revanche, sont relatifs à mon individualité : ils ne doivent pas faire loi, car ils peuvent entrer en conflit avec les désirs des autres, nuire à leur liberté, comme le désir d’exploiter ou de torturer. Par exemple, le désir d’être respecté est relatif à mon humanité, donc universel (tous les humains désirent ou devraient désirer la même chose), tandis que le désir d’exploiter est relatif à mon individualité d’exploiteur (je fais à autrui ce que je n’aimerais pas qu’il me fasse – je n’aurais pas le désir que l’être humain exploite son semblable si j’étais à la place de l’exploité, donc mon désir n’est pas universel : il n’est pas partagé par tous). Comme le dit Kant, nous devons agir comme si la maxime de notre action devait être érigée par notre volonté en loi universelle de la nature. (Par exemple, il serait bon pour nous que la maxime « ne pas nuire à autrui » soit érigée en loi universelle). Notons pour finir que sur le plan politique, quand ceux qui votent les lois doivent ensuite obéir à ces lois, ils ont intérêt à voter des lois justes, ce qui est un avantage de la démocratie.
LA PERCEPTION, PREMIERE PARTIE : GENERALITES
Percevoir, c’est prendre connaissance du réel par les divers sens de son corps. L’on peut distinguer la perception externe (conscience du réel matériel) de la perception interne (conscience de ses pensées). Les « sens » sont les facultés corporelles d’éprouver des sensations et des perceptions. Les « sensations » sont des informations physiques diverses reçues par le corps. Les « perceptions » sont des ensembles de sensations distinctes qui, regroupées par un jugement de l’esprit, forment des objets. En résumé, une « perception » (en ce sens) est un « objet », celui-ci étant simplement un ensemble de sensations. Par exemple, l’objet « feu » (ou la perception du feu) est un ensemble de sensations telles que la couleur orange, la chaleur, la forme mouvante et autres. Percevoir, ce n’est pas seulement sentir (recevoir des sensations), mais juger ce qu’on sent. C’est rassembler plusieurs sensations (couleur orange, chaleur, etc) et juger cet ensemble (en disant « c’est du feu »). Ainsi, l’on pourrait croire que les perceptions sont construites, « médiates », tandis que les sensations sont données, immédiates, non jugées. En réalité, les sensations sont elles-mêmes des perceptions, car aucune sensation n’échappe au jugement de l’esprit. Dire: « c’est chaud » ou « c’est orange », par exemple, c’est déjà un jugement de l’esprit. Ce n’est pas un jugement de valeur (je ne donne pas mon avis subjectif sur la chose, je ne dis pas ce qui devrait être), mais un jugement ontologique (qui porte sur l’être, sur ce qui est) : en effet, je dis ce que c’est. Aucune sensation n’échappe au jugement ontologique, donc toute sensation, en tant qu’elle est toujours jugée par l’esprit, est aussi une perception. A propos de notre rapport au réel (c’est-à-dire de la « perception » au sens large), Platon, dans La République, expose sa célèbre Allégorie de la Caverne : l’idée centrale, c’est que nous sommes dans l’illusion car nous prenons les ombres des choses pour les choses elles-mêmes. Sortir de la Caverne signifie devenir LUCIDE. (Lucide venant du latin « lux » qui signifie « la lumière ».) Pour récapituler les points précédents, les sensations sont des informations physiques. Les perceptions sont nos interprétations de ces informations (par le jugement ontologique). Toute sensation est une perception, mais pas l’inverse : une perception est souvent un ensemble de sensations. Aristote, dans son traité intitulé « De l’Âme », dénomme 5 sens « externes » : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat… L’on peut y ajouter 4 sens « internes » : la proprioception (le fait de situer nos membres), l’équilibrioception (le sens de l’équilibre), la thermoception (le sens des températures) et la nociception (le sens de la douleur). Cette nomenclature reste susceptible d’être affinée par les sciences. *Pour Platon, comme l’écrira plus tard Rimbaud : « la vraie vie est ailleurs » (dans le « Ciel des Idées » et non dans les choses matérielles). Pour Platon, le réel, c’est l’Idéel : la table qui est devant moi n’est qu’une apparence ; l’essence de la table, la table telle qu’elle est, c’est l’Idée de la table. A l’inverse, pour Aristote, la vraie vie est ici-bas : il n’y a pas de Ciel des Idées, il n’y a que ce monde (dont les idées font partie). Autrement dit, ce monde n’est pas qu’une apparence, ce monde n’est pas qu’un pâle reflet du monde des idées ; ce monde est le seul monde réel. Il n’y a pas d’autre monde. « Il n’y a que ça. »
LA PERCEPTION, DEUXIEME PARTIE : PERCEPTION ET REEL
D’après l’opinion commune, le monde existe indépendamment de nous. Percevoir, ce ne serait que prendre connaissance du réel « objectif », le terme objectif signifiant à la fois « qui existe en soi » (c’est-à-dire pas seulement pour nous) » et « qui est le même pour tous ». La matière précèderait l’esprit : l’esprit ne serait qu’un produit de la matière. Ainsi, nous sommes « matérialistes » sans le savoir : nous pensons que le monde a existé avant nous, existera après nous et existe même quand nous ne le percevons pas et quand nous n’y pensons pas. (Petit point de vocabulaire. Par perception, je désigne « le corps percevant », et par Perception de, je désigne « l’acte de percevoir »). Prenons un exemple. Quand nous disons « cette pierre est dure, rugueuse et rouge », nous pensons qu’il s’agit là d’une réalité objective, indépendante de ma perception, qui vaut pour tout le monde. Pourtant, vous en conviendrez, un daltonien la percevra d’une autre couleur… certains animaux la percevront « en noir et blanc », certains insectes ne percevront ni le « dur » ni le « rugueux », etc. Avec une perception différente, nous percevrions un réel différent : ainsi, le réel est subjectif, relatif à la perception que nous en avons. La perception dépend de la structure du corps et des organes. Il y a autant de réels que de perceptions ! Le réel « en soi » ou « objectif » n’existe pas. Le réel est toujours subjectif, c’est-à-dire relatif à une perception. Le réel est inconcevable indépendamment d’une perception de ce réel. Le réel est toujours un réel pour une perception. Cette analyse s’applique aux humains eux-mêmes (et à tous les niveaux, y compris affectifs). Nous avons tous des perceptions singulières, donc il y a autant de réels que d’êtres humains. Comme l’écrit Berkeley, « Être, c’est être perçu ou percevoir. » Un objet n’existe que relativement à une perception (réelle ou possible) de cet objet. Par exemple, le bruit d’un arbre qui tombe n’existe que pour une oreille. La notion de « bruit » n’a de sens que pour un organe sensoriel qui perçoit le bruit. C’est l’oreille qui suscite la réalité du bruit. Hormis le sujet percevant et les objets perçus (ou perceptibles en droit), rien n’existe. Ma perception fait être le réel. La perception n’est pas la simple saisie d’un réel objectif, mais la suscitation d’un réel subjectif.
L'INCONSCIENT, PREMIERE PARTIE : GENERALITES
*Au sens courant, l’adjectif « inconscient » signifie simplement « dont on n’a pas conscience ». De même, quelqu’un qui agit sans avoir conscience des conséquences de ses actes sera péjorativement qualifié « d’inconscient ». Mais « inconscient » signifie étymologiquement « sans avec savoir », ce qui pose un problème : on ne peut pas en même temps savoir et ne pas savoir quelque chose, c’est contradictoire. D’entrée de jeu, l’on voit donc qu’il s’agit d’un concept ambigu. Petit point de vocabulaire préalable : « l’être », « le psychisme », « l’esprit » et « nous-mêmes » sont ici des termes équivalents et interchangeables. L’inconscient peut être défini comme une composante de moi-même dont je n’ai pas conscience, qui constitue la plus grande partie de moi-même et qui dicte mes actes. L’inconscient serait donc « une partie de moi qui n’est pas moi ». « Une partie de moi », c’est-à-dire, pas quelque chose d’extérieur à moi qui m’influence à mon insu, mais quelque chose qui me définit en tant qu’être. Mais « Qui n’est pas moi », c’est à dire qui n’est pas « conscience de quelque chose » (ou rapport au réel), qui n’est pas un néant, mais qui est de l’ordre des choses et dont je n’ai pas conscience. Étant de l’ordre des choses, l’inconscient est un concept réificateur, car il amène à considérer l’être humain comme une chose et non plus comme un néant. L’inconscient serait du spirituel sans conscience. (Spirituel voulant simplement dire « qui relève de l’esprit ».) Pour Descartes, esprit = être = conscience. Les partisans de l’inconscient remettent en cause cette équation et définissent ainsi l’être humain différemment. La conscience ne serait qu’une petite partie du psychisme produite par l’inconscient. D’après Freud, la conscience n’est que le « sommet de l’iceberg ». (L’iceberg étant une image de nous-mêmes). Nommons ici 4 partisans de l’inconscient : Leibniz, Freud, Lacan et Jung. De même, les « philosophes du soupçon » (nommés ainsi par Ricoeur), à savoir Nietzsche, Marx et Freud, remettent en cause l’équation cartésienne selon laquelle « esprit = être = conscience ». L’idée, c’est que la liberté et la raison sont des illusions car l’inconscient dicte nos actes. L’on serait dans l’illusion en croyant que l’on pense et que l’on agit « librement ». (Quand je crois agir pour une raison consciente, en fait, mon acte est l’effet mécanique d’une cause inconsciente). Enfin, d’après Schopenhauer, un « vouloir-vivre » aveugle (à savoir nos instincts biologiques) compose l’essentiel de notre être. Nous ne sommes que des marionnettes de cet inconscient (des marionnettes de l’instinct). A l’inverse, d’après Sartre, il n’y a pas d’inconscient. L’inconscient est une conscience de mauvaise foi, lorsque nous nions ce que nous savons. Autrement dit, la marionnette peut choisir de couper les fils biologiques et sociaux qui la remuent, même si c’est difficile. (Peut-être n’avons-nous que trois possibilités : la satisfaction directe, la répression ou la sublimation. Notre corps et notre société nous gouvernent d’une main de fer, mais nous faisons des choix à chaque instant, « il n’y a de liberté qu’en situation », comme l’écrit Sartre, or la situation peut-être très contraignante, très influençante et offrir peu de possibilités réelles). Il y a d’un côté la « conscience », c’est à dire l’être humain (qui n’est pas une chose mais un rapport aux choses), et de l’autre, les choses, par définition non humaines. Les réalités qui nous influencent à notre insu ne font pas partie de nous. Il vaudrait mieux donc parler d’Inscient (qui signifierait étymologiquement « sans savoir » et qui renverrait donc à du « non-humain »), que l’on pourrait définir comme l’ensemble des réalités inconnues qui ont des effets sur nous. L’inscient serait l’ensemble des causes inconnues d’effets connus et éprouvés. Ne pas définir l’être humain comme un objet mais seulement comme un esprit, d’un point de vue humaniste, est important.
L'INCONSCIENT, DEUXIEME PARTIE : EXEMPLES DE THEORIES
*Leibniz est le premier philosophe à invoquer la notion d’inconscient en parlant de « petites perceptions inconscientes » (par exemple quand nous dormons). L’on pourrait donc percevoir sans savoir que l’on perçoit (ce qui est contradictoire, car percevoir, par définition, c’est sentir et juger ce qu’on sent). 3 philosophes pensent que l’être humain est composé d’un inconscient (qui constituerait la plus grande partie de notre être) : Schopenhauer, Marx et Nietzsche. 3 autres penseurs ont davantage creusé cette notion : Freud, Lacan, Jung. Freud distingue 2 « topiques » (c’est-à-dire deux niveaux d’explications du psychisme). Première topique : les lieux psychiques : le conscient (ce dont j’ai actuellement conscience), le préconscient (les souvenirs disponibles pour la conscience) et l’inconscient (les souvenirs indisponibles pour la conscience en raison du refoulement (c’est-à-dire de l’expulsion de ces derniers hors de la conscience) et de la résistance (c’est-à-dire de leur empêchement de revenir à la conscience)). Deuxième topique : les instances de la personnalité (ou composantes et tribunaux psychiques de la personnalité) : le ça (les pulsions), le surmoi (la morale héritée de l’éducation, une morale qui est donc arbitraire et qui n’a donc rien à voir avec la « vraie morale » : par exemple, un enfant de dealers aura un surmoi de dealer), et le moi (le « chercheur de compromis » entre le ça et le surmoi). L’inconscient est constitué par nos traumas et nos désirs refoulés. Le but de la psychanalyse (ou cure par la parole) est ainsi de ramener l’inconscient à la conscience afin de devenir plus libre (autrement dit que nos actes ne soient plus « dictés » par l’inconscient). Lacan partage avec Freud cette idée d’inconscient. Il insiste davantage sur son lien au langage. L’inconscient est structuré comme un langage, écrit-il. L’inconscient, c’est le discours de l’Autre en nous, tout ce qui en nous, dans nos paroles et nos pensées, vient de l’Autre avec un grand A (c’est à dire de l’extérieur) sans qu’on en ait conscience. Nos paroles trahissent souvent notre inconscient. D’où l’importance, pour le psychanalyste, d’être attentif à chaque parole de son patient (pour faire revenir l’inconscient à la conscience). Enfin, Jung forge la notion d’inconscient collectif qu’il définit comme un ensemble de représentations inconscientes qui viennent de la culture commune et qui s’intègrent à notre identité. Il est « collectif » car il est commun à tous les membres d’une même culture. Enfin, le « Vouloir-vivre » de Schopenhauer et la « volonté de puissance » de Nietzsche désignent nos instincts biologiques, c’est-à-dire, pour Schopenhauer et Nietzsche, notre inconscient qui dicte nos actes. Lorsque nous croyons agir pour des motifs rationnels, en fait, nous agissons à cause de raisons inconscientes liées à ces instincts. Schopenhauer invite à se libérer le plus possible de ces instincts (au profit de l’éthique et de la contemplation), ce qui est paradoxal au vu de sa philosophie déterministe (en effet, si l’on n’est pas libre, alors l’on ne peut pas se libérer du vouloir-vivre). Nietzsche, au contraire, invite à « assumer » nos instincts et à les suivre. Pour Sartre, à l’inverse, ces instincts sont des réalités extérieures à nous (c’est-à-dire des réalités qui ne font pas parties de nous, qui ne nous définissent pas). L’être humain n’est que conscience. Il n’y a pas d’inconscient, il n’y a que la conscience d’un côté et les choses de l’autre (d’où la phrase « toute conscience est conscience de quelque chose »)... Même si nous sommes manipulés à notre insu (par nos instincts ou par la société), nous faisons toujours des choix à chaque instant et nous ne nous définissons par aucune représentation consciente ou inconsciente.
AUTRUI
Autrui, c’est étymologiquement « l’alter ego », c’est-à-dire « l’autre moi ». Autrui est à la fois semblable et différent de moi : différent, car il est « autre que moi », et semblable, car c’est un « autre moi », c’est-à-dire un être humain comme moi (un être conscient comme moi). Je sais que j’existe (on l’a vu avec Descartes). Mais comment être certain qu’autrui existe ? Je fais l’expérience de ma conscience, mais non de celle d’autrui. Je suppose l’existence d’autrui par raisonnement (ce que montre Descartes) et par un sentiment spontané (ce que montre Husserl). Je suis le centre du monde : le monde gravite autour de moi, mais autrui, par son regard, me vole ma position de centre et fait de moi une chose parmi les choses. Le rapport à autrui prend donc inévitablement la forme d’un « combat de centres ». Le paradoxe d’autrui est le suivant : c’est « un moi qui n’est pas moi ». Pour saisir la difficulté principale concernant autrui, il importe de comprendre le concept de « solitude » au sens philosophique du terme : je suis « seul », c’est-à-dire que je suis le seul à être moi. Personne ne peut vivre à ma place, être moi à ma place. (Personne ne peut souffrir, jouir, travailler, s’amuser, contempler et mourir à ma place). Pour moi, l’autre c’est l’autre, mais pour l’autre, l’autre c’est moi. Il n’y a que pour moi que je suis moi. Quand il m’arrive de croire qu’autrui « vit la même chose » que moi, c’est toujours une illusion : autrui, par définition, vit toujours une expérience différente de la mienne. Par exemple, face à un « même » paysage, autrui ne voit pas le même paysage que moi. Je ne sais jamais ce qu’autrui ressent : je n’ai pas accès à sa conscience. Autre grand problème : autrui, par son regard, me « réifie », autrement dit, me « transforme en chose », me considère comme une chose (ce que montre Sartre). Autrui m’enferme dans une définition, il me réduit à une représentation qu’il a de moi. Réciproquement, je réifie autrui par mon regard. C’est pourquoi, comme l’écrit Sartre, « autrui est d’abord pour moi l’être pour qui je suis objet ». Quand je dis : « telle personne EST ceci ou cela », je la réifie. Or, comme l’écrit Sartre, « Je ne suis pas ce que je suis parce que je change » : j’échappe à toute définition, autrui aussi. La seule « vraie définition » de l’être humain, c’est de ne pas en avoir. Autrui, comme moi, n’est pas un objet mais un rapport au réel, un néant par lequel il y a de l’être. Pour ne plus réifier autrui, il faut accepter sa transcendance, c’est-à-dire le fait qu’il nous échappe, l’impossibilité de le connaître. Pour connaître autrui, il faudrait être à sa place, mais alors, ce ne serait plus autrui, mais moi. Connaître autrui est donc par définition impossible. Par exemple, l’amour authentique ne consiste pas à croire que l’on connaît l’autre (ce qui est toujours une illusion), mais à savoir que l’on croit en l’autre. Il s’agit d’un acte de confiance, non de connaissance. Accepter la solitude, c’est accepter le fait qu’on ne connaît jamais autrui et qu’autrui ne nous connaît jamais. Sur le plan pratique, c’est renoncer à son désir de connaître l’autre et de le posséder, car ce désir est voué à l’échec, (ce qui, notons-le, est un rempart contre toute perversité relationnelle, ce qui n’est pas rien). Pour Kant, être « majeur » au sens philosophique du terme, c’est ne pas se laisser dicter sa vie par autrui par peur de sa liberté : c’est disposer de sa vie, oser penser (et non s’en remettre à des « tuteurs » qui disposent de notre vie et qui nous disent ce qu’on doit penser).
LE DÉSIR
« Désir » vient du latin « desiderioum » qui signifie « regret ». « Desidéraré », en latin, veut dire « cesser de contempler l’étoile », « regretter l’astre éteint ». « Désir » et « désastre » ont ainsi la même étymologie : « de sidouss », qui signifie l’astre éteint. Le désir semble ainsi être une expérience malheureuse. Désirer, ce serait regretter l’absence de quelque chose, manquer de quelque chose. « Désir » serait synonyme de « manque » et de « frustration ». L’on ne pourrait désirer que ce que l’on n’a pas. Le désir exclurait « l’ataraxie » (c’est à dire l’absence de troubles). L’on peut distinguer 2 définitions du Désir. Première définition : Désirer, c’est tendre vers quelque chose que l’on aimerait posséder (ce qui suppose qu’on ne possède pas cette chose). En ce sens, le désir est un signe de dépendance et nous condamne à l’insatisfaction. Le Désir, en ce sens, est un synonyme de manque et de frustration. Par définition, l’on ne peut désirer que ce qu’on n’a pas. Deuxième définition : Le Désir est la Puissance de jouir, c’est-à-dire la potentialité ou la capacité de jouir. En ce sens, le désir se distingue du manque. L’on peut jouir de ce qu’on a, de ce qu’on est en train de faire. En résumé, au premier sens de Désir, Désir est synonyme de manque, et au second sens de Désir, le Désir désigne la capacité de jouir. Une question se pose : suis-je malheureux parce que je n’ai pas ce que je désire ou parce que je désire ce que je n’ai pas ? Un argument se présente en faveur de la définition du désir comme puissance : ne plus avoir de désir n’est pas un signe de complétude et d’accomplissement (comme le suggérerait l’équivalence entre désir et manque), mais de dépression, de mal-être. Je vous renvoie sur ce point aux travaux du philosophe André Comte-Sponville. Il convient de distinguer les désirs (pulsions, caprices, etc) du Désir avec un grand D (qui porte sur les horizons qu’on vise : être heureux, donner un sens à sa vie, améliorer le monde, etc). La volonté, quant à elle, consiste à se donner les moyens d’atteindre ces horizons. Les désirs (avec un petit d) doivent servir le Désir (avec un grand D), (pour ne pas nous vouer au malheur ou à la superficialité). Pour vivre la vie que je désire vivre, il est important pour moi de distinguer ce qui relève des causes efficientes (instincts mécaniques) de ce qui relève des causes finales (buts que je me fixe) dans mon rapport au monde. *La sagesse consiste à trier les désirs. Pour cela, Épicure classe nos désirs en trois catégories : les désirs naturels et nécessaires (manger, boire, se loger, se soigner, etc), les désirs naturels et non nécessaires (sexualité, bonne nourriture, sport, etc) et les désirs non naturels et non nécessaires (luxe, gloire, pouvoir, etc). Être sage, pour Épicure, c’est ne satisfaire que les désirs naturels (nécessaires et non nécessaires). Les philosophes stoïciens, eux, insistent sur l’importance de ne pas être esclave de ses désirs. Sénèque, dans son livre intitulé La vie heureuse, nous invite à considérer le plaisir comme « un plus » plutôt qu’un but. Si l’on suit un bon chemin (c’est-à-dire le chemin de notre Désir avec un grand D et non de nos désirs avec un petit d), le plaisir viendra en accompagnement sans qu’on aille le chercher. Enfin, Désirer renoncer au Désir est contradictoire et déconseillé : contradictoire, parce que désirer renoncer au désir, c’est encore désirer, et déconseillé, parce que l’absence de Désir nous conduit à la dépression, ce qui est l’un des plus grands malheurs.
L’EXISTENCE
Exister signifie étymologiquement « se tenir debout hors de » (ex sistéré), être hors de soi, tourné vers les choses. Exister, c’est donc être « jeté au monde » à chaque instant (comme le montrent Heidegger et Sartre), c’est-à-dire jeté hors de soi, vers des choses extérieures à soi. « Toute conscience est conscience de quelque chose » (comme l’écrit Husserl). La conscience n’a pas d’intérieur. La conscience est toujours en relation avec des choses extérieures à elles, elle se projette toujours vers l’extériorité. Ainsi, exister, c’est ne jamais être chez soi mais toujours hors de soi. La Vie, comme l’écrit Bichat, c’est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort, autrement dit, c’est une réalité biologique (c’est à dire le corps). La vie, c’est le fait de vivre, autrement dit de satisfaire ses instincts (manger, boire, se loger, etc). L’Existence, c’est le fait d’être conscient, non seulement de vivre mais aussi de savoir qu’on vit : autrement dit, c’est une réalité spirituelle (c’est à dire l’esprit). L’être humain n’est pas seulement un vivant, comme l’animal, mais aussi un existant. La Solitude, c’est le fait que personne n’est à ma place : je suis le seul à être moi. Nos parents permettent d’expliquer comment nous sommes venus au monde (par le mécanisme biologique de la procréation…), mais pas pourquoi. Les trois maîtres-mots de l’existence sont la contingence, l’absurde et la déréliction. La Contingence, c’est le fait que ce qui est aurait pu ne pas être ou être autrement. Est contingent ce qui est là sans raison. Nous sommes des êtres contingents : nous n’avons aucune raison d’être (nous aurions pu ne pas naître ou naître dans d’autres conditions biologiques, sociales, géographiques et historiques). Le monde est contingent. L’Absurde, c’est ce qui n’a pas de sens (ni de direction ni de but). Si l’existence avait un sens, nous ne serions pas libres mais soumis à ce sens. (Par exemple, dans les religions, nous devons suivre le « bon chemin », le « bon sens », la « bonne direction », pour ne pas être des « impurs »). L’existence est absurde, donc nous choisissons le sens que nous lui donnons. L’Absurde est ainsi la condition de la Liberté. L’existence est absurde, donc elle nous appartient. Enfin, la Déréliction, c’est le fait d’être jeté dans un monde qu’on n’a pas choisi, sans que notre existence ait été voulue ou désirée. (Mes parents ont désiré « un enfant », mais l’enfant que je suis aurait pu être quelqu’un d’autre, c’est le principe de la contingence. Personne n’a précisément voulu ou désiré celui ou celle que je suis. Vouloir être aimé(e) revient à vouloir oublier la déréliction (car c’est vouloir être désiré pour celui qu’on est, comme si l’on avait voulu notre existence, ce qui est impossible.) Éthiquement parlant, ceux qui m’imposent la vie (les parents) ont donc des devoirs éthiques envers moi, même si je ne corresponds pas à l’enfant qu’ils imaginaient. « La cause du monde » est une notion contradictoire, car ce serait une cause sans cause, ce qui est scientifiquement impossible. (Ou alors, il faudrait chercher la cause de la cause, puis la cause de la cause de la cause, puis la cause de la cause de la cause, et ce jusqu’à l’infini). C’est ce que l’on appelle le mystère de l’être : il est impossible d’expliquer pourquoi il y a un monde et pourquoi nous existons. L’être est sans cause, ou plutôt, l’être n’a pas d’autre cause que l’être lui-même, ce qui suppose qu’il y a toujours eu de l’être.
LE TEMPS
L’une des grandes caractéristiques de l’existence est la « finitude », c’est à dire le fait d’avoir une fin, d’être limitée dans le temps. L’existence se déroule dans le temps, elle est soumise au temps (car l’on ne peut pas vivre en dehors du temps, sauf en imagination). Nous sommes mortels parce que nous sommes des êtres temporels. Le temps est une notion très complexe, car l’on ne peut pas le définir sans employer des synonymes (« durée, évolution… ») ou des métaphores (« écoulement, flot… »). C’est une notion impalpable, que l’on comprend de l’intérieur mais qui nous échappe, que l’on a du mal à se représenter clairement. Commençons par énoncer la définition du dictionnaire. Le temps, d’après le TLF, c’est le « milieu indéfini et homogène dans lequel se situent les êtres et les choses et qui est caractérisé par sa double nature, à la fois continuité et succession. » Or, « Continuité » et « succession » sont de vagues synonymes de « temps ». La continuité, c’est ce qui dure, ce qui reste. La Succession, à l’inverse, c’est ce qui change, ce qui ne reste pas. Toute chose temporelle a un début, un milieu et une fin. Mais le temps lui-même n’a jamais commencé et ne finira jamais. (En langage mathématique, on peut dire que le temps a commencé à « moins l’infini » et finira en « plus l’infini » : le temps est là depuis toujours et sera toujours là). Le temps, c’est donc l’éternité. Le mot « Temps » vient du grec temnein qui signifie « couper ». Cela supposerait que le temps est sécable, c’est-à-dire divisible en instants. Il convient de distinguer le « temps objectif », divisible, mesurable et indépendant de notre ressenti, du « temps subjectif », c’est-à-dire du temps tel que nous le ressentons. Aristote et Newton ont défini le temps comme objectif, mathématisable et s’écoulant toujours à la même vitesse. Pour Einstein, le temps est bien objectif, mais relatif à chacun (plus on se déplace vite et/ou plus on est proche d’une masse importante, plus notre temps s’écoule lentement). Le temps a incontestablement une dimension tragique car il est à la fois irréversible et innaccélérable, l’on ne peut ni revenir dans le passé ni aller dans l’avenir. Pour Kant, le temps est subjectif, c’est un prisme de la perception (comme l’espace) à travers lequel on appréhende le monde. Pour Bergson, il convient de distinguer le « temps » (qui est objectif, spatialisé et sécable) de la « durée » (qui est subjective, distincte de l’espace et insécable). Pour Bergson, le vrai temps, c’est la durée, c’est-à-dire le temps tel qu’on l’éprouve, non tel qu’on le mesure. Le temps objectif, c’est de l’espace qui devient une image du temps, comme en témoignent les rectangles des calendriers et les intervalles des horloges qui sont des réalités spatiales utilisées pour penser le temps. Enfin, pour Saint-Augustin, le temps est subjectif, c’est-à-dire relatif à la conscience. Seul le présent est. Il y a trois temps, non le présent, le passé et l’avenir, mais le présent du passé (la mémoire), le présent du présent (l’attention actuelle) et le présent de l’avenir (l’attente). Notons que le présent du présent est le seul temps sur lequel on a une prise réelle, d’où l’importance de se focaliser le plus possible sur ce temps afin de ne pas tomber dans les passions tristes (regrets, remords et nostalgie portant sur le présent du passé, ou anxiété, angoisse, craintes et attentes impatientes portant sur le présent de l’avenir).
L’ÊTRE HUMAIN
Qu’est-ce que l’être humain ? Pour les religieux, c’est une créature de Dieu. Pour les matérialistes, c’est un produit de la Nature. Pour les existentialistes, c’est un être conscient qui n’a été créé par personne et qui ne fait pas partie de la Nature. Mes parents m’ont certes imposé la naissance ainsi que la vie biologique et sociale qui s’ensuit (ils m’ont imposé la « condition humaine » avec des structures biologiques, psychologiques et sociales que je n’ai pas choisies), mais ils ne sont pas les auteurs de ma conscience, même s’ils m’ont beaucoup influencé. Paradoxalement, c’est ma conscience qui suscite la réalité de la vie biologique et sociale que l’on m’impose. Je suis la source absolue d’un réel que je n’ai pas choisi. En tant que vivant, je ne suis qu’un produit de mes parents, de mes ancêtres, de la Nature et de la société, mais en tant qu’existant, je suis la source absolue. Or, mes appartenances biologiques et sociales ne me définissent pas : je ne suis pas une chose, je suis un être humain (c’est-à-dire un rapport aux choses qui ne se confond pas avec les choses elles-mêmes, un sujet et non un objet). Que je sois noir ou blanc, bourgeois ou prolétaire, etc, cela ne change rien à mon statut d’être humain. J’échappe à toute définition chosifiante. Il n’y a donc pas de définition à laquelle je devrais me conformer. L’être humain est une conscience. « L’inconscient » désigne en fait du non-humain, donc il s’agit seulement de « l’inscient » (car ce n’est pas de l’ordre de la conscience mais des choses). Il y a d’un côté l’esprit humain, et de l’autre, les choses, par définition non-humaines. « Toute conscience est conscience de quelque chose » (comme l’écrit Husserl). Je suis « conscience de quelque chose », je suis un rapport à des choses toujours extérieures à moi, un rapport qui ne cesse de changer. « Je ne suis pas ce que je suis parce que je change » (comme l’écrit Sartre). Mais la conscience n’est pas un « esprit pur » : c’est par notre corps que nous avons conscience des choses. Il faut donc distinguer le corps-objet (le corps biologique) du corps-sujet (notre conscience corporelle du monde, le corps comme lieu de la perception, autrement dit, non le corps perçu mais le corps percevant). Je suis une conscience, c’est à dire un corps-percevant. L’Existentialisme est la théorie selon laquelle l’existence précède l’essence. L’Homme existe d’abord, il se définit ensuite. Une essence, c’est « ce qu’est un être ou une chose », autrement dit, une définition. Les essentialistes pensent que nous avons tous une définition qui nous préexiste et à laquelle nous devons nous conformer. Par exemple, pour les machistes, l’essence de la femme est d’être soumise à l’homme. « C’est comme ça ! », diront-ils. A l’inverse, pour les existentialistes, il n’y a aucune définition à laquelle nous devons nous conformer : nous choisissons la définition que nous nous donnons. (Le féminisme différentialiste n’est qu’un machisme inversé : la femme serait supérieure à l’homme. Le féminisme existentialiste affirme à l’inverse que la femme est l’égale de l’homme). La Seule définition vraie de l’être humain est la suivante : l’être humain est conscience, esprit, corps-sujet (ou « corps propre », expression qu’utilisent les phénoménologues pour parler du « corps-percevant », qui n’est autre que l’esprit).
LA LIBERTÉ
Le mot « liberté » a fondamentalement 3 sens. Au sens concret ou physique, c’est la possibilité matérielle de faire quelque chose. Au sens social et juridique, c'est le fait d'avoir le droit de faire quelque chose (droit qui m'est accordé ou refusé par les autres, donc qui dépend des autres). Je peux être physiquement libre de faire quelque chose et pas socialement, ou à l'inverse socialement libre, mais pas physiquement. (Par exemple, je peux tuer mon voisin, mais je n'en ai pas le droit – et j'ai le droit de m'envoler comme un oiseau, mais je ne peux pas). Dans les deux cas, liberté est un synonyme de possibilité (matérielle ou sociale). Enfin, au sens philosophique, la liberté est simplement le fait de faire des choix – autrement dit, le fait que nos actes (pensées y compris) ne soient pas mécaniquement produits par des causes extérieures à nous : c’est ce qu’on appelle aussi le libre-arbitre. Une pierre qui tombe ne choisit pas de tomber : elle tombe à cause de la gravité, elle ne peut pas ne pas tomber. Mais quand je fais telle ou telle chose, est-ce que je choisis de la faire ou est-ce que je la fais à cause d'autre chose ? Telle est la question qui oppose partisans du libre arbitre et déterministes (d’après ceux-ci, tout, y compris nos actes, est mécaniquement produit par des causes). Je suis une liberté en acte (c’est-à-dire une liberté « réelle » : tant que je suis conscient, je fais des choix à chaque instant, je ne suis pas une liberté seulement « possible » et « virtuelle »). Être libre, c’est simplement faire des choix, autrement dit, ne pas être une chose. (Ne pas être un simple objet soumis aux lois mécaniques du monde, mais être un sujet, une personne). Mais la liberté n’exclut ni l’ignorance, ni la contrainte, ni l’impuissance, ni le fait d’être influencé (consciemment ou non) par des réalités extérieures à nous. Par exemple, je peux être contraint par les autres de faire telle ou telle chose (même si je suis toujours libre de leur désobéir), je peux ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, je peux ne pas savoir pourquoi je fais telle ou telle chose et/ou pourquoi je ressens telle ou telle chose, je peux croire que j’agis pour telles raisons alors qu’en fait j’agis pour d’autres raisons, etc. (L’on pourrait donc aussi définir la liberté comme la capacité de s’extraire le plus possible des influences et des contraintes qui pèsent sur nous, par exemple en obéissant inflexiblement à la loi qu’on s’est prescrite, sans céder à la pression des instincts et d’autrui). L’Intérêt de la biologie et de la sociologie (et de toutes les sciences s’intéressant aux réalités qui ont une incidence sur l’être humain) est le suivant : ces sciences nous aident précisément à connaître les faits qui nous influencent et/ou nous contraignent afin de s’en distancier, voire de les changer (par la médecine, la politique, le militantisme, etc). Mais pouvoir choisir de faire de la biologie et de la sociologie pour devenir plus « libéré », c’est à dire moins « influencé » et moins « contraint » (par la Nature et par la société) suppose que nous sommes libres. (Si nous n’étions pas libres, par définition, nous ne pourrions pas choisir quoi que ce soit). Ni déterminisme (selon lequel le libre arbitre est une illusion), ni existentialisme (selon lequel le réel ne m’impose rien), mais influencialisme (je suis libre tout en étant contraint et influencé par le réel). C’est parce que nous sommes libres que nous pouvons essayer d’augmenter notre savoir, de devenir + puissants et de nous libérer des influences et des contraintes qui pèsent sur nous.
LE DEVOIR MORAL
Le devoir, c’est simplement ce que je dois faire et plus encore ce que je ne dois pas faire (selon tel ou tel critère que l’on choisit). Par opposition aux devoirs souvent arbitraires qui me sont imposés par la vie sociale, le devoir moral s’impose à moi de l’intérieur : pour que mes actes ne soient pas moralement condamnables, je dois agir conformément au devoir moral. Le devoir moral n’est donc pas une contrainte (c’est-à-dire une pression « extérieure ») mais une obligation (c’est-à-dire une pression « intérieure »). La Contrainte, c’est : « si tu fais ceci, tu le paieras ». L’Obligation, c’est : « si tu fais ceci, tu agiras mal (même si tu ne le paieras pas) ». L’obligation, étymologiquement, comporte l’idée de lien. L’obligation est ce qui me lie aux autres. Tout d’abord, sans devoir moral, la vie en société est impossible : c’est la guerre de tous contre tous (plus de liens, chacun pour soi). Ensuite, si je ne respecte pas mon devoir moral envers les autres, je romps le lien qui me lie à eux : je ne mérite plus de vivre parmi eux car je leur nuis. (Notons entre parenthèses que cette analyse est valable en droit, c’est-à-dire du point de vue de ce qui devrait être, mais non en fait, c’est-à-dire du point de vue de ce qui est. De fait, il existe des « mauvaises personnes » bien intégrées à la société et des « bonnes personnes » exclues de la société, même si en droit, cela ne devrait pas être. Ainsi, je n’ai pas à me justifier envers ceux qui me nuisent, car se justifier, c’est reconnaître la légitimité de l’attaque de l’autre, or ceux qui ne respectent pas leur devoir envers moi n’ont pas la légitimité d’obtenir mon écoute : le dialogue ou la guerre, il faut choisir). D’après Kant, notre devoir moral est de traiter autrui comme une fin en soi et non comme un moyen. Autrement dit, ne pas l’instrumentaliser : ne pas le considérer comme un objet, comme un moyen en vue de servir nos buts, mais comme un sujet, comme une personne : ne pas l’utiliser comme le simple « instrument » de nos plans. L’être humain est un être digne, quelles que soient ses appartenances biologiques ou sociales (qu’il soit blanc ou noir, riche ou pauvre, etc). Digne signifie « qui mérite d’être respecté ». La dignité est inséparable de l’humanité, tous les humains méritent d’être respectés. Tous les êtres humains sont également dignes : il est donc légitime de condamner les actes bafouant la dignité humaine. Être digne, c’est ne pas être un objet, ne pas être un moyen, mais un « but en soi ». Quand on m’utilise comme un moyen, l’on bafoue ma dignité. Mais un grand problème « pratique » se pose : si l’on ne s’utilisait pas les uns les autres, la vie en société serait impossible... (En effet, pour survivre, l’on a besoin de travailler les uns pour les autres). Kant propose ainsi un clair-obscur qui se traduit par la formule suivante : ne jamais traiter l’être humain SEULEMENT comme un moyen MAIS TOUJOURS AUSSI comme une fin. En d’autres termes, il s’agit de s’utiliser les uns les autres, mais le moins possible et le plus respectueusement possible, sans jamais oublier qu’en droit, il ne faudrait pas (puisque l’Homme est un but en soi). Enfin, réduire le plus possible les contraintes qui s’imposent à l’être humain est le meilleur moyen de l’instrumentaliser le moins possible. Par exemple, réduire la pénibilité du travail, permettre l’euthanasie et le suicide assisté pour que l’on ne soit plus contraint à vivre, ne pas imposer une vie laborieuse ou prédéfinie aux enfants que l’on met au monde, envisager un « revenu universel » pour que l’on ne soit plus contraint à travailler, faire moins d’enfants pour ne pas rendre les générations futures victimes de la surpopulation, etc. L’enjeu humaniste est de tendre le plus possible vers la « vraie liberté » (au sens de « possibilité matérielle et sociale »), celle qui se déploie sans nuire à autrui. Non la liberté de certains aux dépends de celles des autres, mais la liberté de tous.


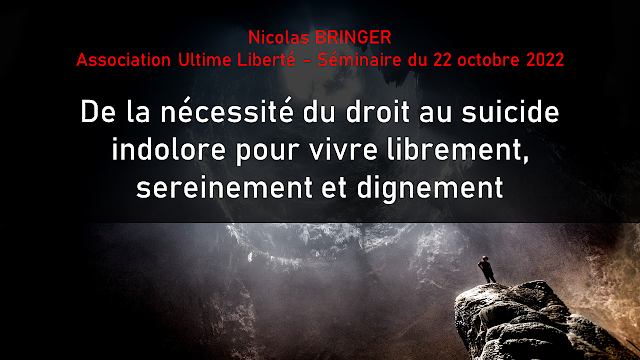

Commentaires
Enregistrer un commentaire